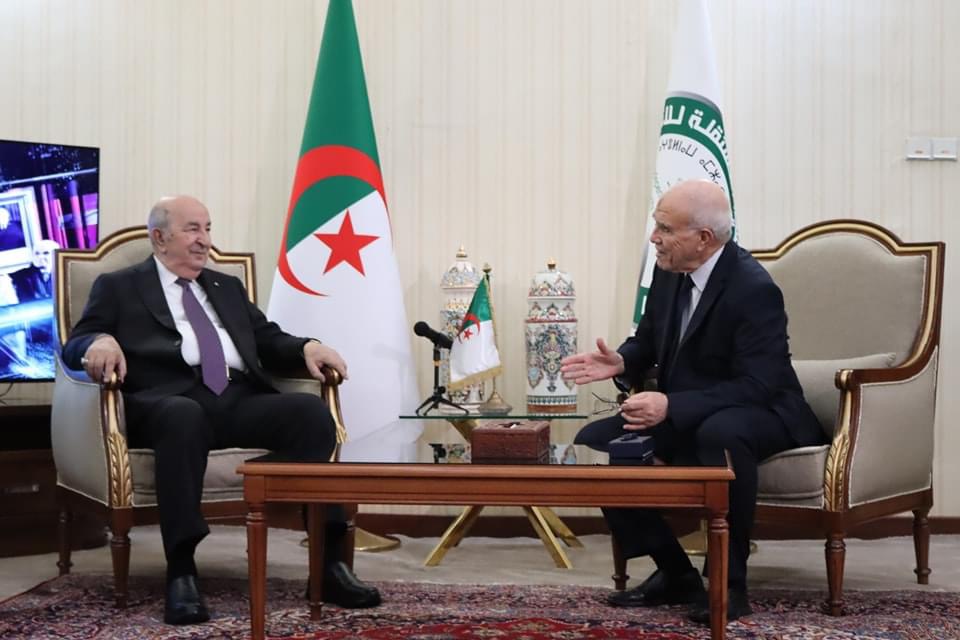Si le rendez-vous d’évaluation de 2010 a été raté, le prochain est prévu normalement pour l’année 2015. Il est sans doute encore temps de le préparer plus sérieusement que le premier et de ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Les dirigeants politiques algériens n’aiment pas vraiment l’Accord d’association. L’argument qu’ils évoquent le plus souvent, à demi-mot, pour justifier sa ratification, est que ce fut le prix à payer pour desserrer l’étau diplomatique autour du pays. On peut apprécier diversement l’argument. Mais le débat n’est plus d’actualité. L’accord est là, c’est une réalité incontournable qui s’impose juridiquement à l’Etat algérien et à ses institutions. Depuis bientôt près de dix années, c’est une zone de libre échange qui, dans les faits, régit nos relations économiques et commerciales avec 28 pays d’Europe dont l’Union forme aujourd’hui la première puissance économique et commerciale mondiale.
Les autorités algériennes s’accommodent comme elles peuvent de cette réalité inquiétante et restent perplexes devant l’usage à faire de ce gigantesque bâtiment qui encombre le rivage de nos relations économiques et commerciales avec le monde. En effet, donner un sens à tel accord supposerait, en amont, des réformes structurelles de l’économie auxquelles elles n’arrivent pas à se résoudre. D’un autre côté, même si les conditions politiques qui ont pu justifier sa signature ne sont plus d’actualité, elles ne se décident pas non plus à en dénoncer le contenu.
2 milliards de dollars perdus chaque année
Faute pour les autorités algériennes de pouvoir dégager une perspective, dans un sens ou dans l’autre, le résultat le plus palpable de l’Accord est celui qui consiste à transférer chaque année, vers les pays de l’Union, près de deux milliards de $US de revenus budgétaires sans contrepartie, selon l’estimation communiquée en 2012 par l’ancien ministre des finances. La « révélation » de M. Djoudi venait en appui à une demande de révision du calendrier de démantèlement tarifaire, initialement convenu dans l’accord. Celle-ci finira, bon gré mal gré, par être acceptée. Le résultat obtenu a été de réaménager ce calendrier en repoussant au maximum, vers la fin du programme, les impacts financiers les plus lourds. Il a surtout consisté à rallonger de trois années supplémentaires la période de démantèlement, en la faisant passer de 12 à 15 années, reportant ainsi l’échéance finale de 2017 à 2020.
Les problèmes renvoyés à 2017
Si, à première vue, le compromis ainsi obtenu parait avoir du sens en termes purement financiers. En termes économiques, en revanche, le message qu’il envoie à nos partenaires, est que c’est la gestion des recettes douanières qui, seule, nous tient lieu de boussole, les réformes de notre politique commerciale, de même que la diversification de notre tissu économique, ne faisant pas partie des priorités. Personne ne semble avoir mesurer à quel point l’ampleur des changements qui vont affecter brutalement la protection effective des marchés internes à partir de 2017 risque fort d’être vécue comme un obstacle infranchissable par les investisseurs nationaux ou étrangers. En outre la décélération trop rapide du niveau des recettes douanières entre 2017 et 2020 opérera avec un « effet de boulet » très difficilement supportable pour nos finances publiques. Et la situation risque de s’avérer encore plus ardue si l’on ajoute que, selon toutes les projections disponibles, cette même période sera des plus critiques pour les équilibres du budget de l’Etat algérien.
Une attitude schizophrénique
Les partenaires économiques de l’Algérie éprouvent aujourd’hui du mal à saisir la cohérence réelle de notre politique commerciale. Nos restrictions à l’investissement sont un véritable non-sens économique pour tous les secteurs d’activité où, précisément, nous nous sommes engagés à démanteler notre protection douanière. A qui pourrait-on expliquer valablement pourquoi nous accueillons ainsi à bras ouverts des marchands qui viennent écouler chez nous leurs produits, alors que nous érigeons des barrières face à des investisseurs qui souhaiteraient fabriquer ces mêmes produits sur notre marché ?
Mais alors, à quoi sert vraiment cet accord d’association ? On peut s’interroger sur cette attitude schizophrénique de nos propres autorités qui, d’un côté, appliquent scrupuleusement ses dispositions les plus contraignantes et, de l’autre, s’acharnent à saper les quelques leviers qui auraient pu contrarier sa douloureuse étreinte ou ouvrir la piste d’un horizon économique nouveau. C’est presque l’attitude d’un enfant qui, faute d’en faire à sa tête, en viendrait à casser les meubles de la maison.
Prochain rendez vous d’évaluation en 2015
Il faudra bien, un jour, commencer par faire ce que tous les pays du monde font, face aux contraintes que leur posent leurs accords de commerce, à savoir une évaluation froide et méthodique de leur impact. Du reste, l’accord d’association prévoit, une fois au moins tous les cinq ans, des rendez vous solennels durant lesquels les deux parties procèdent, de manière contradictoire, à ce type d’évaluation. En 2010, cinq années après la mise en œuvre de l’accord, c’est un cabinet français, recruté et financé par la partie européenne, qui a procédé à l’évaluation en question, pour le compte et à la demande de la partie algérienne. Comme on pouvait s’y attendre, son rapport, rendu public[i] , reflétait plutôt un point de vue européen et ne s’appesantissait pas réellement sur les déséquilibres profonds de l’accord.
Si ce rendez-vous de 2010 a été raté, le prochain est prévu normalement pour l’année 2015. Il est sans doute encore temps de le préparer plus sérieusement que le premier et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Tous les pays peuvent, par mégarde ou sous la pression, être amenés à conclure une mauvaise affaire. S’il ne s’agit que de commerce, ce ne sont pas là des fautes rédhibitoires. Ce qui serait bien plus inquiétant, ce serait de ne même plus chercher à rectifier le tir.