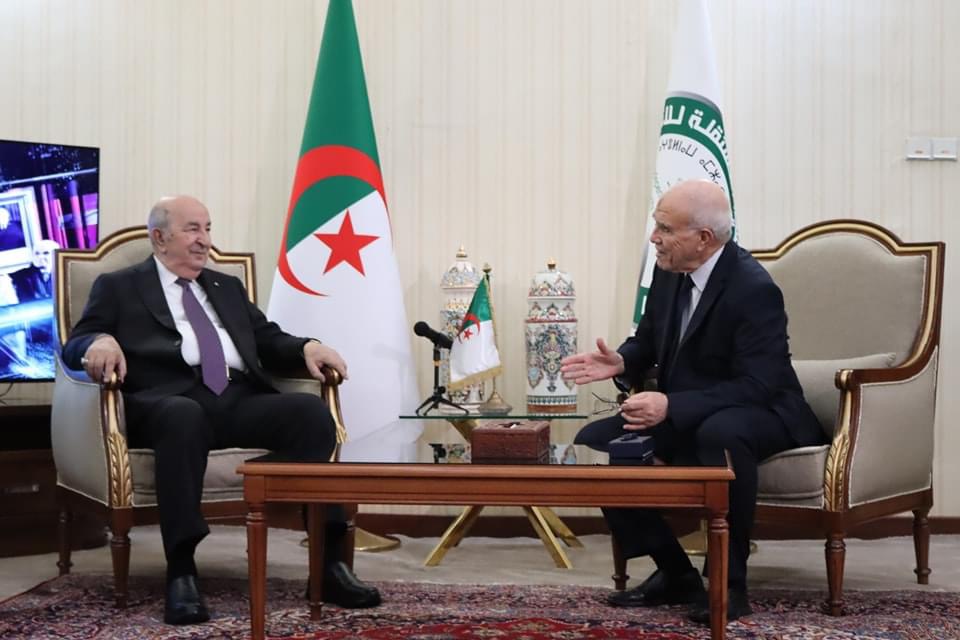Dans le paysage économique algérien, Rachid Sekak présente le profil rarissime d’un expert financier ayant exercé des responsabilités élevées aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, en Algérie et à l’étranger..Dans l’interview exclusive qu’il a accordée à Maghreb Emergent, il livre un diagnostic à la fois précis et nuancé sur la situation financière du pays. Il tente également d’ouvrir quelques pistes de réflexion à propos de la gestion de nos marges de manœuvres économiques et financières.
Maghreb émergent : Quelle lecture faites-vous de la situation financière du pays et de ses perspectives pour les prochaines années ?
Rachid Sekak : Un constat s’impose dès à présent. La situation des finances publiques est plus tendue que celle de la balance des paiements. Le niveau actuel des réserves de change, qui se situaient à 159 milliards de dollars à fin juin 2015, procure une certaine visibilité à la balance des paiements pour peu que le prix du baril évolue entre 50 et 70 dollars et que la quantité d’hydrocarbures exportés cesse de reculer au cours des 4 ou 5 prochaines années. A contrario, la situation des finances publiques est plus tendue et nécessite un ajustement fort et immédiat.
C’est une situation qui m’inspire plusieurs commentaires : Tout d’abord, les facteurs sous-jacents à la baisse du prix du pétrole, qui est à l’origine de la fragilisation de notre situation financière, sont largement en dehors du contrôle de l’Algérie. Nous n’avons aucune emprise sur les prix internationaux. Ensuite, la conjoncture, révélatrice de nos vulnérabilités, nous impose d’agir et de nous ajuster pour atténuer les menaces qui en découlent sur notre développement économique et nos équilibres sociaux. Les hydrocarbures représentent en, effet, un tiers de notre PIB, près des deux tiers de nos recettes budgétaires et 98 % de nos exportations. Mais cette conjoncture difficile et complexe offre aussi une excellente opportunité d’introspection et de prise de virage audacieux, pour construire une nouvelle vision économique et modifier nos modes de fonctionnement et de régulation.
Une note d’optimisme, néanmoins : comme cela a été relevé par beaucoup d’experts, notamment ceux du Fonds monétaire international (FMI), nos marges de manœuvre sont plus importantes qu’en 1986. Nous disposons de réserves de change conséquentes, gérées avec prudence par la Banque centrale d’Algérie. Notre dette extérieure est faible (environ 3 milliards de dollars) et bon marché (le service de la dette représente 1 % de nos exportations). Et notre dette publique est actuellement relativement modeste.
Mais ces marges de manœuvre bien réelles ne doivent surtout pas être avancées pour justifier un statu quo. Il ne s’agit pas de ne rien faire car la fenêtre de tir est étroite. Il ne faut ni s’alarmer, ni s’endormir, mais bouger dans la bonne direction avec ambition et courage. Est –ce le cas actuellement ?
Les équilibres budgétaires étant actuellement les plus menacés, est-ce que les mesures prises dans la loi de finances complémentaire pour 2015 et celles annoncées pour la loi de finances pour 2016 vous paraissent suffisantes ?
Je dirais que les mesures annoncées vont dans le bon sens mais traduisent une sensibilité qui accorde un primat aux équilibres sociaux par rapport aux équilibres économiques. Les mesures prises, notamment à travers une réduction des dépenses d’équipement plus sensible que les celle des dépenses courantes, suggèrent qu’implicitement, on attend un retournement du marché pétrolier. On est donc dans une démarche qui recherche un ajustement à la conjoncture et non pas des réformes structurelles
Or, soyons clairs, la baisse du prix du pétrole n’est pas la cause de la crise ; elle n’en est que le révélateur. Refuser cette évidence c’est aussi refuser de remettre en cause un modèle économique obsolète basé sur la rente et la dépense budgétaire.
Le principal problème c’est qu’on ne voit pas actuellement démarrer les grands chantiers de réforme. Pour ne citer qu’un seul exemple : nous devons arrêter de subventionner les riches. La politique de subventions tout azimuts mise en œuvre depuis plusieurs décennies est non seulement coûteuse mais elle créé également une forte demande d’importations et induit une consommation excessive d’énergie, notamment de carburants et d’électricité. Elle est, en outre, injuste parce qu’elle bénéficie en fait principalement aux couches les plus aisées de la population. On peut faire mieux avec moins de ressources financières en élaborant un système de transferts monétaires directs en direction des couches les plus défavorisées. Il est souhaitable de subventionner les ménages plutôt que les produits.
Quelles sont les marges de manœuvre dont dispose encore le gouvernement en matière de gestion des finances publiques ?
Les marges de manœuvre dans ce domaine sont de plusieurs natures. La première est l’utilisation du Fonds de régulation des recettes de l’Etat (l’épargne budgétaire), dont les ressources étaient à fin juin dernier, selon les chiffres de la Banque d’Algérie, de 3.341 milliards de dinars et seraient clairement épuisées, toutes choses égales par ailleurs, vers la fin 2016 ou le début 2017.
La seconde option est l’augmentation de la dette publique qui est actuellement faible et représente environ 8% du PIB. Cette option pose deux questions importantes : le marché local des capitaux peut-il absorber l’accroissement attendu de la dette publique ? Il faudrait y trouver entre 23 et 28 milliards de dollars en équivalent dinars ! Par ailleurs, le pilotage monétaire du pays sera complexe dans un contexte de forte réduction attendue de la liquidité bancaire où les variables comme l’inflation, la hausse des taux et le risque d’éviction de l’investissement privé par le Trésor public seront difficiles à optimiser. Il y a, certes, aussi la possibilité de lancer un emprunt national auprès de la population. Mais est-ce que les conditions de succès d’une telle opération sont remplies actuellement ?
En fait, il faudrait, sans doute, à l’étape actuelle, privilégier et accélérer plutôt le développement du marché des capitaux. Il permettra de moderniser la gestion des entreprises publiques et privées et une meilleure absorption de notre dette publique, tout en élargissant le champ des possibilités de financement pour les entreprises.
D’autres pistes doivent aussi être explorées. Les dépenses courantes de l’Etat ont doublé entre 2008 et 2015. N’est-ce pas là un indice de gaspillage ? Par ailleurs, qui ne s’interroge pas sur l’efficience de nos investissements publics et sur leurs processus de maturation, d’exécution et de contrôle ? La rationalisation des dépenses publiques s’impose.
Quelle appréciation faites-vous de la gestion de la valeur du dinar par la Banque d’Algérie au cours des derniers mois ? La dévaluation du dinar par rapport au dollar et à l’euro risque-t-elle de se poursuivre ? Avec quelles conséquences ?
La Banque d’Algérie est dans son rôle en procédant à des ajustements progressifs de la valeur du dinar. A cette occasion, elle donne aussi clairement un petit coup de main aux finances publiques en accroissant mécaniquement le niveau de la fiscalité pétrolière. On peut supposer que le gros de l’ajustement dans ce domaine a déjà été fait et que les éventuels ajustements à venir dépendront essentiellement du niveau d’inflation observé en Algérie par rapport à celui de nos principaux partenaires commerciaux.
Les mesures prises par la Banque d’Algérie depuis un peu plus d’une année en matière de contingentement des crédits destinés au financement du commerce extérieur ne semblent pas, pour l’instant, avoir produit d’effets significatifs en matière de réduction des importations. Comment expliquez-vous leur faible efficacité ? Ces mesures, renforcées au cours de l’été dernier, sont-elles porteuses de risques en matière de financement des investissements et des approvisionnements des entreprises productives ?
La révision à la baisse du ratio des engagements extérieurs est un instrument d’une efficacité redoutable qui aura, sans aucun doute, des effets déflationnistes sur le niveau des importations. A condition que les importateurs n’arrivent pas à remplacer le crédit documentaire par la remise documentaire comme mode de règlement des importations, ce qui suppose une disponibilité du fournisseur à expédier sa marchandise sans engagement bancaire. Mais il semble clair qu’une réflexion doit être menée pour atténuer les effets restrictifs de la nouvelle réglementation qui touche aussi bien les activités de revente en l’état que les activités productives génératrices de croissance et d’emplois.
Si la gestion des déséquilibres de la balance des paiements s’annonce moins tendue que celle du budget de l’Etat, une baisse encore plus importante et prolongée des cours pétroliers ne semble pas exclue. Existe-t-il dans cette hypothèse des instruments financiers susceptibles de se substituer au recours pur et simple à la consommation des réserves de change, une solution qui semble adoptée jusqu’ici ?
Des mécanismes simples de couverture financière sont disponibles, qui peuvent permettre à l’Algérie, si elle en fait le choix, de s’assurer contre les effets d’une possible poursuite de la baisse des prix du pétrole.
Les Etats (ou bien les compagnies pétrolières nationales) peuvent, en effet, souscrire des produits d’assurance qui leur assurent un niveau garanti de revenus pétroliers. En contrepartie du versement d’une prime, l’institution qui émet la protection s’engage à compenser les pertes de recettes qui surviendraient lorsque le prix du baril de pétrole passerait en dessous du prix fixé dans la garantie. La souscription de l’assurance d’un prix plancher prend la forme de l’achat d’options.
Si, par exemple, un Etat souscrit une couverture pour un prix du baril à 50 USD, et que le prix du baril s’établit à 30 USD, il reçoit une compensation qui correspond à l’intégralité des pertes de recettes par rapport au prix de référence de 50 USD. Ce qui revient de facto à s’assurer d’un prix-plancher du baril de pétrole à 50 USD.
A titre de référence, s’assurer il y a quelques mois pour un prix du baril à 50 USD coûtait approximativement 3 USD par baril. Si le prix du baril sur les marchés spot passe à 30 USD, l’Etat qui a souscrit l’assurance se voit donc indemnisé et reçoit 20 USD. Si le prix du baril s’établit par exemple à 70 USD, l’Etat qui s’est assuré ne reçoit pas de compensation, mais ne débourse rien non plus.
Le Mexique assure de cette manière l’intégralité de ses revenus budgétaires tirés du pétrole (un tiers de ses recettes totales) depuis le début des années 1990. L’adoption de ces mécanismes d’assurance a ainsi permis au Mexique de recevoir, par exemple, une compensation de 9 milliards USD en 2009 suite à la chute des prix du pétrole.
En Algérie, la couverture pour s’assurer d’un prix plancher pourrait être souscrite soit par la Sonatrach, soit (plus logiquement encore) par le Fonds de régulation des recettes. Ce fonds, en souscrivant ces mécanismes d’assurance, remplirait ainsi pleinement sa fonction d’assurer un « lissage » des revenus budgétaires tirés du pétrole pour le pays. Le temps d’une plus grande modernité financière n’est- il pas arrivé ?
Propos recueillis par Hassan Haddouche
Le dessin à la Une est signé « Yacine » et publié sur Econews.