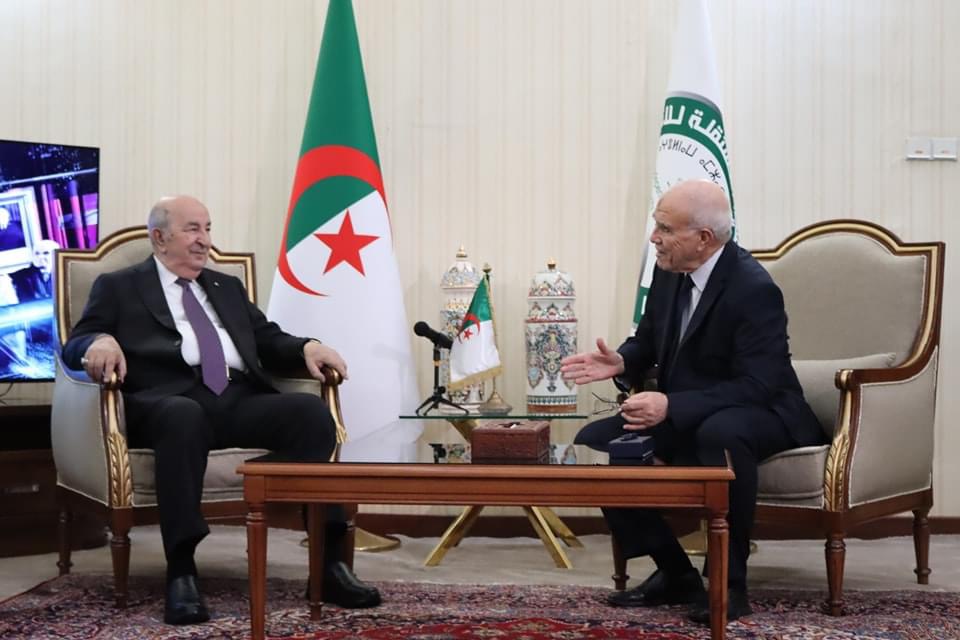L’économiste Samir Bellal soutient que l’ouverture d’une usine Peugeot en Algérie est un autre épisode de la série des mécanismes « importations déguisée ». Il estime que ce projet n’apportera pas grand-chose à l’économie du pays.
Maghreb Emergent : Le Gouvernement a déclaré, par la voix de l’ex-ministre de l’Industrie Mahdjoub Bedda, que l’industrie automobile algérienne est une « importation déguisée ». Une réforme avait été promise. Mais rien ne fut. On nous annonce l’installation de Peugeot en Algérie. Peugeot fera-t-elle aussi de « l’importation déguisée » ?
Samir Bellal : Absolument. On nous annonce la mise en place d’une capacité de montage de quelques milliers d’unités alors que chez notre voisin de l’Ouest il est question de centaines de milliers. Tous les spécialistes du domaine de la construction automobile vous diront que ce type d’investissement n’est pas viable. Pour le constructeur Peugeot, il s’agit simplement de préserver (ou de récupérer) une part de marché, mais pour le pays, il s’agit bel et bien d’une importation « déguisée », mais nullement d’un projet industriel crédible. A voir la nature et surtout le nombre des projets de montage lancés ou annoncés, on constate aisément que le phénomène prend une telle ampleur qu’on ne peut même plus qualifier l’opération d’importation déguisée.
Le Gouvernement algérien a présenté l’industrie automobile comme étant la locomotive de l’industrialisation. Or, concrètement, il n’en est rien, la taille des usines installées en Algérie (Renault, Hyundai, Volkswagen) étant trop petite pour qu’une quelconque chaine de sous-traitance émerge. Pourquoi le Gouvernement s’obstine-t-il dans cette voie ?
La question reste posée. Tels qu’ils sont configurés, les projets lancés ou annoncés fonctionneront comme de véritables pompes à aspirer les ressources en devises du pays. Leur impact sur l’emploi est faible, pour ne pas dire marginal, et le transfert de technologie absent. Selon toute vraisemblance, l’industrie de sous-traitance dont on nous annonce un avenir florissant se limitera aux composants de plastique. Telle qu’elle est conçue, cette industrie n’a pas d’avenir. Elle continuera à exister tant qu’elle bénéficiera d’une protection extérieure (blocage des importations) et d’avantages fiscaux faramineux, et surtout tant que le pays dispose de ressources en devises larges et suffisantes.
Les IDE en Algérie se déclinent davantage sous forme de partenariats commerciaux que de partenariats économiques gagnant-gagnant. C’est patent dans le secteur automobile et latent dans les autres secteurs. Est-ce une fatalité ?
Le problème en Algérie est qu’il n’y a pas véritablement une politique nationale en matière d’accueil et d’encadrement des IDE. L’espace économique national est exposé à une grande ouverture (ouverture des frontières, désarmement douanier, monnaie surévaluée…) et l’IDE n’est pas soumis à des priorités nationales.
La règle des 51/49 % en est l’illustration caricaturale. Il n’est en effet nul besoin d’être un grand expert en économie pour comprendre qu’il est préférable d’avoir un investissement détenu à 100% par le partenaire étranger mais qui rapporte des devises au pays (en exportant sa production) que d’avoir des projets détenus à plus de 51 % par le capital national mais dont la vocation finale n’est que l’extraction, dans le double sens du terme, des ressources nationales et leur transfert vers l’extérieur. Le spectacle auquel nous assistons aujourd’hui ne doit pas nous surprendre.
Il nous rappelle la vieille contradiction, connue dans la théorie économique, entre la libre circulation internationale des marchandises et celle des capitaux, puisque l’une et l’autre tendent, en cherchant à égaliser les conditions de production à l’échelle internationale, à s’exclure mutuellement. Mais comme nos décideurs politiques, et notamment Ouyahia, ne croient pas à la théorie économique, il y a malheureusement tout lieu de croire que nous avons affaire à une fatalité.