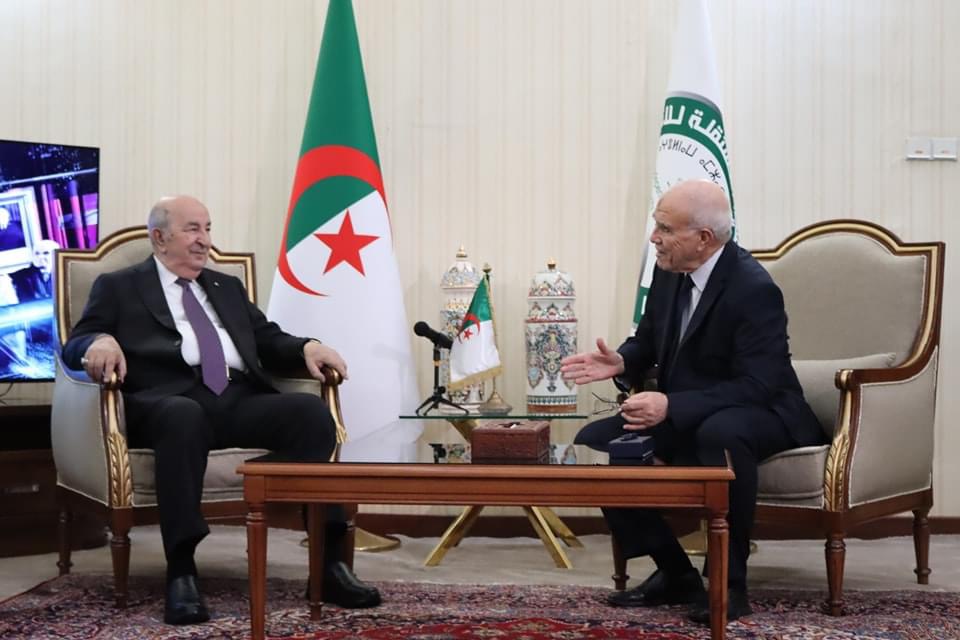La semaine économique déroulée dans la chronique d’El Kadi Ihsane sur El Watan tente de comprendre ou se situe la séquence Bejaia sur le chemin de la crise algérienne.
Il ne faut pas faire attention aux déclarations de circonstances. Le pouvoir politique algérien pensait avoir acheté du temps. Les évènements de Bejaia lui montrent qu’il n’en a presque plus. La dernière séquence semblable à ce début janvier 2017 n’est pas lointaine. Les émeutes surprises de janvier 2011. Liées à un climat de mal vie chez la jeunesse populaire et à un sentiment de précarité, déjà à ce moment, chez les acteurs de la distribution. A cause d’une disposition légale – l’obligation de déclaration de la TVA chez les grossistes – rendant le commerce moins profitable ou plus aléatoire. Le scénario est donc assez voisin. En 2011, il a viré au drame. 04 morts et des dizaines de blessés. Cette fois le pire a été évité. Ce n’est pas peu pour affronter la suite. Sur le fonds, les ressemblances sont fortes. Un Etat en mal de revenus fiscaux tente d’élargir son assiette en rendant formelle une partie importante du commerce informel. Les émeutes de janvier 2011 ont été présentées autant comme les émeutes du sucre et de l’huile (ridicule) que celles du commerce informels qui voulait revenir à la situation antérieure. La réponse publique, outre la répression immédiate, a été de faire machine arrière toute, d’inventer une nouvelle subvention du sucre et de l’huile puis d’accompagner le mouvement de contestations des fonctionnaires en augmentant leurs salaires et celui des jeunes en assouplissant le dispositif ANSEJ dans les faits. En gros, les émeutes de janvier 2011 ont aggravé les conditions futures du déficit budgétaire à partir de 2014 et du retournement du marché pétrolier. Celles de janvier 2017 peuvent tout au mieux faire ralentir le plan d’ajustement en cours du gouvernement. Une affiche des émeutiers de Bejaia portait bien une revendication claire « non à la loi de finance de 2017». Hausse de la TVA de deux points, hausse du prix du carburant de 8% à 15%, hausse des timbres et taxes, jusqu’à 300% . Elle appauvrit les algériens. Il n’y a pas lieu de chercher plus loin les raisons de la colère. D’autant qu’il s’agit de la seconde loi de finance paupérisante. Celle de 2016 avait également touché aux tarifs de l’électricité et provoqué des mouvements sociaux dans le sud Algérien. A la différence de 2011 donc la situation sociale s’est tendue d’entrée en 2017 en contexte de péril sur les finances publiques. Cela change t’il la donne de l’action publique en profondeur ? Pour cela il faudrait comprendre le moment du cycle économique.
Deux prises d’otages de l’activité
La gouvernance économique de Bouteflika- Ouyahia-Sellal a pris deux fois l’activité en otage en Algérie. La première fois parce qu’elle se sentait très riche en 2008-2012. La seconde parce qu’elle se sent proche de la banqueroute en 2015-2017. Le réflexe de riche de la fin de la décennie 2000 a été de reprendre le contrôle direct de la création de richesse par le pouvoir politique. Tant pis si cela ralentit la croissance du PIB, elle est de toute façon tirée par la dépense publique. C’est l’ère de l’arrêt de l’exploration hors Sonatrach dans l’amont pétrolier (qui se prolonge à nos jours) ; de l’exclusion de l’investissement direct étranger avec le 51-49 ; du droit de préemption à la moindre modification dans les statuts des entreprises étrangères en Algérie. C’est aussi le début, avec les tracas de Cevital, de la guerre aux grands investisseurs privés algériens qui ne marchent pas au pas du sérail. La prise d’otage est d’affirmer que l’Etat ne délègue rien au privé tant qu’il est « riche » : le monopole de Algérie Télécom sur Internet se poursuit, celui des banques publiques sur le marché financier écarte le privé national, et les transports aériens et maritimes demeurent fermés. Pour ne citer qu’une partie des secteurs otages. La seconde prise d’otage est en cours. L’Etat sur une pente de déficits durables rackette dans l’urgence la partie émergente de son économie. Il a fait semblant en 2015 avec l’opération de mise en conformité fiscale d’ouvrir la porte à l’argent de l’informel pour le rendre bancable et surtout imposable. Mais il a bien sur échoué. Et s’est retourné, avec son emprunt national, vers l’épargne captive des institutionnels publics et privés. Le déficit du trésor est financé par les résultats des entreprises déposées dans le circuit bancaire. C’est de l’argent qui est symboliquement retiré à la croissance de l’investissement pour financer le maintien des gaspillages de « l’Etat qui fait tout ». Surtout l’Etat qui achète du temps. Les différentes hausses de la loi de finance pour 2017 sont également l’expression de cette prise d’otage. La hausse de la TVA de deux points abandonne la piste de l’élargissement de l’assiette fiscale recherchée il y a deux ans pour se payer sur l’existant par plus de pression fiscale. Le mot d’ordre des preneurs d’otages, version Etat en cours de faillite, en devient qu’il n’y a plus de temps. Plus le temps pour des réformes de moyen terme. Pourtant seules ces réformes là sont salutaires. Elles suggèrent l’inverse d’une captation à froid. Elles disent en gros qu’il faut créer de nouvelles richesses au lieu de ponctionner un peu plus celles disponibles. Diversification ? Cela fait quatre ans que le gouvernement Sellal en parle. Il bute sur deux obstacles à l’étiologie équivalente. La rente pétrolière et le syndrome Benali- Trabelsi.
Le CNI sous le spectre Ben Ali-Trabelsi
Le printemps tunisien célèbre son sixième anniversaire le 14 janvier prochain. L’occasion de rappeler ici au pouvoir algérien une des raisons qui a précipité la chute du président Ben Ali. L’investissement s’est passablement ralentit en Tunisie les cinq dernières années avant le coup de grisou de Sidi Bouzid. Une des explications est largement cernée dans le langage subtil d’un rapport de la banque mondiale sur le climat des affaires aux dernières années de Ben Ali. Le clan présidentiel emmené par Leila Trabelsi a retardé la diversification de l’économie en voulant être partenaire – de fait – de tous les nouveaux promoteurs de projets nouveaux en Tunisie. Il n’en fallait pas plus pour qu’une grève silencieuse de l’investissement s’insinue. Chez les tunisiens et chez les étrangers. En Algérie la prégnance sur la création de richesse nationale du CNI ; le conseil national sur l’investissement, qui choisi les bons et les mauvais investisseurs est un doux syndrome Benali – Trabelsi. En Algérie, les projets de partenariat avec le capital étranger ou dans les secteurs encore non démonopolisés dépendent de plus en plus ces dernières années de la proximité avec le cercle d’amis présidentiel. La diversification algérienne a le rythme de capacité d’investissement du groupe Kounineff et du groupe Haddad. Pour ne citer que les plus puissants dans le cercle. Bien sur ce n’est pas équivalent à ce que faisait Leila Trabelsi qui réservait même les boutiques de la zone free de l’aéroport de Carthage a sa famille. Mais les conséquences, in fine, sont proches. L’investissement est ralentit. Et la diversification retardée. La rareté du temps c’est ce syndrome qui l’a créé. Et avec elle la cécité politique qui fait couper au plus court. Taxer les otages.