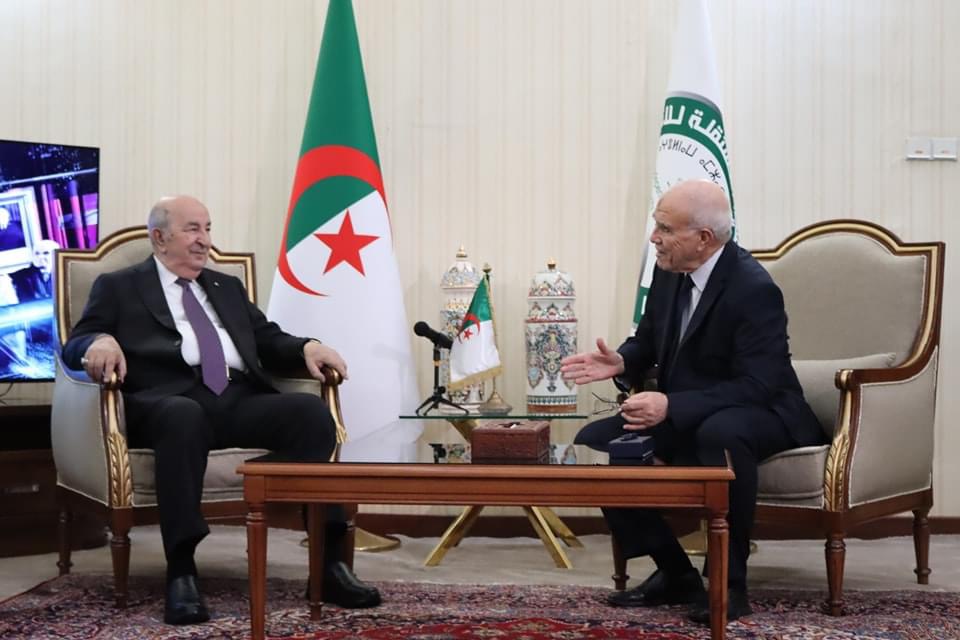Le groupe Saida, qui active aujourd’hui dans l’agroalimentaire sous la direction de Samir Yaici, prend de l’ampleur et étend sa présence dans le marché chaque jour un peu plus. Ses mots d’ordre ? La qualité et l’originalité.
Les premiers pas
« Les Yaici, on en tue, on en emprisonne, mais il y a toujours quelqu’un pour s’occuper des affaires de la famille ». Cette phrase, c’est un responsable militaire français qui l’a prononcée, durant la colonisation, au sujet de la famille de Samir Yaici qui, contre vents et marées, persévérait dans l’investissement et tenait ses affaires pour un bien à protéger tout aussi dignement que son honneur. En effet, les Yaici, dont beaucoup de membres se sont engagés dans la lutte de libération nationale, estimaient que la révolution était aussi dans le développement économique et social du pays.
« Le groupe Saida exerce aujourd’hui essentiellement dans l’agro-alimentaire. Son existence et la place qu’il occupe dans le marché revient aux ainés qui ont maintenu les affaires de la famille depuis les années 40 », nous indique Samir Yaici, PDG du Groupe. « Dans les années 30, on a fait la grande distribution dans l’agroalimentaire, principalement dans la région de Sétif. Mais, très vite, nous nous sommes lancés dans l’industrie. Notre première activité industrielle, c’était la confiserie. On produisait Fosta et Zigumar à Al Hamma, à Alger, qui était le poumon de l’industrie en Algérie. Cette activité est née suite à la reprise d’une usine des parents des Jean Daniels (l’éditorialiste vedette du Nouvel Obs.), Armand et Jean Daniel, qui étaient des confiseurs. La Compagnie Générale des Confiseries qui leur appartenait a été reprise par mon grand-père et son frère aux alentours des années 1958-60 », a-t-il confié, visiblement fier d’être l’héritier mais gêné par une secrète peur de ne pas être à la hauteur des « ainés ».
« Mon père, appelé par le devoir, il s’est enrôlé dans les rangs du FLN/ALN et a occupé des postes de responsabilités dont celui de chef de mission en Allemagne. Malheureusement, l’attentat du SDECE le 1er janvier 1960 à Francfort à l’hôtel Palmenhof lui a coûté ses deux mains. II est alors rentré en Tunisie, ensuite au Caire. Il avait 38 ans. Il a fait partie de la constituante et, tout de suite après, il est revenu à sa vie de citoyen simple et s’est occupé de sa familles et de ses affaires. Entre temps, c’était son frère qui gérait la confiserie que nous avions reprise », a-t-il ajouté en soulignant que cette usine a toutefois été cédée à la famille d’Abdelkader Figa dans les années 80.
Quand investir est un défi
Au lendemain de l’indépendance, les inquiétudes que tout investisseur peut légitiment avoir quant à l’avenir de son investissement se sont vite dissipées. Et une éclaircie, appuyée par un élan révolutionnaire très puissant, a encouragé les Yaici à continuer leurs affaires et à les développer. Toutefois, la famille ne s’est pas contentée d’investir dans la confiserie. Bien au contraire, elle a très tôt misé sur la diversification des ses investissements.
« Juste après l’indépendance, on a lancé à Sétif deux projets. Un projet dans la torréfaction de café durant une trentaine d’année qu’on commercialisait sous le label Turkia et un deuxième projet industriel dans la production des carreaux de sol avec une unité à Sétif, une autre à Annaba et deux unités à Alger dont la dernière a été réalisée en 1997 », nous a déclaré Samir Yaici. Néanmoins, le lancement et le développement de ces projets n’était pas chose aisée. Car, aussi volontariste soit l’Etat algérien au lendemain de l’indépendance, son choix d’inscrire son économie dans une logique dirigiste, voire hostile au capital privé, a été un frein majeur à l’émergence d’entreprises privées de taille. La période allant de 1962 à la fin des années 80 marquée par l’ouverture opérée par Chadli Bendjedid, est désignée à juste titre par « la période de la psychose des nationalisations », les quelques entreprises privées existantes vivaient dans la peur permanente d’être nationalisées. De fait, investir durant cette période était un défi majeur que les Yaici ont relevé. « Nous avons investi malgré les obstacles que nous rencontrions à l’époque. Parce que nous croyons en ce que nous faisons. Nous n’investissons pas que pour gagner de l’argent », affirme M. Yaici.
La recherche d’opportunités et la reprise de Saida
La recherche d’opportunités d’investissement et le propre de tout businessman. C’est le cas des Yaici qui ont à la fois le flair et la passion des affaires. « Nous avons géré nos investissements dans le café et les carreaux de sol jusqu’à ce que l’Etat a décidé d’ouvrir le capital de certaines entreprises publiques et de privatiser certaines autres. C’est dans ce cadre que nous avons décidé de changer de cap et d’investir dans l’eau. Ainsi, nous avons été adjudicataire du projet d’Oued Fodda de Sétif. Nous avons alors lancé la marque Djemila. Ce projet n’a malheureusement pas marché, d’une part, parce que quand nous l’avons repris, le projet était à l’abandon, d’autre part, parce que, entre temps, une autre opportunité s’est présentée à nous, celle d’exploiter la marque Saida qui était déjà commercialisée et très connue, une sorte de brand love, un générique. Le transfert effectif de Saida s’est fait en 2008 et là, on s’est dessaisi du projet d’Oued Fodda. Aujourd’hui, la marque Saida, qui a beaucoup perdu de son prestige avant d’être reprise par les Yaici, occupe une bonne place sur le marché.
« La marque Saida n’est pas leader en volume, parce qu’on revient de loin. Saida est la marque la plus ancienne mais sa relance est jeune. Quand on a repris Saida, elle n’était pas du tout en bonne santé. De plus, il n’est pas facile d’investir dans une ville située à plus de 500 Km de la capitale et qui souffre d’un désinvestissement total, une ville agropastorale où des déficits énormes en mains-d’œuvre qualifiée et en cadres sont enregistrés », nous a expliqué Samir Yaici, plutôt optimiste quant à l’essor que prend cette marque avant de continuer : « Aujourd’hui, l’attractivité des villes et au cœur des débats économiques. J’ai, par exemple, un investissement, est-ce que je l’installe à Setif, à Béjaia ou Saida ? C’est naturellement la ville qui présente le plus d’avantages qui va attirer l’investisseur le plus. Car, les cadres dirigeants, par exemple, refusent souvent d’aller dans les villes de l’intérieur ou le cadre de vie enregistre des carences. Nous avons relevé le défi pour la marque Saida et ça a marché malgré tous les problèmes qui se dressaient devant nous. Aujourd’hui, je considère que Saida, qui produit plus de 5 millions de litres par jour, est une véritable succes story.»
L’internationalisation et les nouveaux défis
L’aventure Saida des Yaici a pris un autre chemin : l’internationalisation. « Nous avons internationalisé le projet. Vers la fin 2012 et début 2013, nous avons conclu un partenariat avec le troisième groupe mondial dans les boissons, le Groupe Suntory, pour la production de plusieurs marques ici en Algérie dont Orangina et Casera. Nous avons déjà commencé à produire ces deux marques. La Casera est normalement commercialisée et elle commence à prendre du terrain. En 2018, elle sera disponible sur tout le territoire national. Pour Orangina, nous avions eu un contentieux lié à la dénomination avec un entrepreneur qui exploite cette marque localement depuis des années. Pour le moment, nous la produisons le plus normalement du monde dans la légalité mais le contentieux n’a pas encore connu sa fin », explique M. Yaici non sans préciser que, « aujourd’hui, Saida est le référent en matière d’agrumes ».Mais pas seulement car, en plus des boissons d’agrumes, Saida a aussi développé l’eau pétillante.
« Nous sommes l’un des rares à proposer ce produit aux Algériens car toutes les eaux ne sont pas carbonatables et Saida l’est parce qu’elle est principalement à caractère bicarbonaté et magnésien », détaille Samir Yaici qui ajoute que, « en matière de production de jus, de boisson gazeuse et d’eau pétillante, les capacités de l’usine sont estimées à plus 200 millions de litres par an ». Toutefois, « l’ambition du groupe Saida n’est pas que de prendre des part importantes dans le marché algérien, mais aussi d’exporter. « L’exportation est une perspective hautement stratégique pour nous. C’est même une obligation, un gage de qualité. On gagnera beaucoup à raisonner en termes de balance des paiements. Idéalement, il faut au moins financer les intrants importés qu’on utilise», explique Samir Yaici.