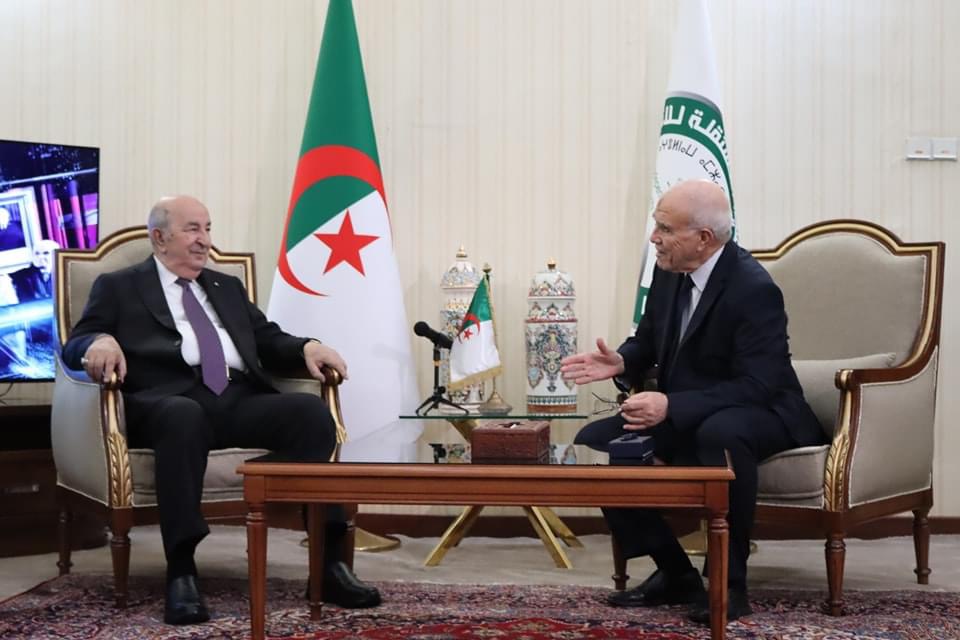Nous republions ici l’entretien accordé au journal français La Tribune.fr par Jean-Louis Levet. Pour ce haut responsable à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne, les rapports économiques franco-algériens doivent privilégier désormais la coopération et la coproduction et non plus seulement le commerce.
La Tribune : Quels sont les arguments en faveur d’une coopération forte entre la France et l’Algérie, telle que vous la préconisez avec une grande conviction ?
Jean-Louis Lever : Coopérer, c’est vouloir travailler ensemble sur le long terme. On coopère parce qu’on a besoin l’un de l’autre, tant il est vrai qu’une partie de l’avenir de la France passe par l’Algérie et qu’une partie de l’avenir de l’Algérie passe par la France.
On voit bien aussi que dans la mondialisation économique où l’incertitude ne cesse de croître, la concurrence entre les grandes firmes mais aussi entre les États est de plus en plus rude. Cette concurrence, à la fois sur le prix et sur la qualité croissante, y compris des nouveaux pays industrialisés, nécessite de nouvelles formes de relations. C’est pour cela que l’axe stratégique sur lequel j’ai construit ma mission, depuis mai 2013, consiste à dire : nous devons accélérer la transition, entre la France et l’Algérie, d’un mode de relations fondé sur le commerce à un mode de relations fondé sur les partenariats déterminant le développement économique et social. Même si, bien sûr, l’un n’exclut pas l’autre. C’est d’ailleurs la philosophie même de la « Déclaration de Coopération et d’Amitié » signée en décembre 2012 à Alger par les deux Présidents, François Hollande et Abdelaziz Bouteflika avec beaucoup de lucidité et d’engagement réciproque, dans laquelle s’inscrit ma mission.
Aussi, quand vous observez aujourd’hui l’échiquier mondial des États-nations, vous n’avez pas d’équivalent, sur un plan économique et stratégique, au duo France-Algérie. En particulier parce qu’il y a une proximité géographique, linguistique, culturelle, et plusieurs millions de personnes qui ont de la famille de chaque côté de la Méditerranée.
D’une façon plus globale, sur le plan stratégique, nous pouvons dire que le duo Paris-Alger est au cœur de l’interface Europe-Afrique. L’Algérie est au cœur de l’Afrique du Nord, avec des pays très importants comme le Maroc et la Tunisie. Pour un pays comme la France, Paris-Alger doit jouer un rôle aussi structurant que Paris-Berlin.
La France et l’Allemagne, comme nous le savons, jouent un rôle déterminant, depuis plusieurs décennies dans la construction de l’Europe et pour son avenir. Avec l’Algérie, c’est le chantier de la Méditerranée occidentale qu’il s’agit de faire progresser en termes de prospérité et de sécurité, les deux étant bien sûr très liés.
Comment appréhendez-vous votre mission ?
Les économistes des pays d’Afrique du Nord nous disent que cette zone doit créer 30 millions d’emplois dans les vingt prochaines années. Cela signifie qu’il leur faudra développer des dynamiques de croissance extrêmement fortes, endogènes. Mais la croissance endogène exige d’avoir une économie diversifiée, car moins vulnérable aux secousses de l’économie mondiale, source d’emplois et de métiers très diversifiés en termes de qualification, et répondant mieux aux besoins sociaux de la population, d’attirer des investissements directs étrangers, de développer l’éducation, la formation, etc.
Sur la base de ce constat, la démarche de ma mission consiste à partir à la rencontre de mes interlocuteurs algériens, de leurs attentes, de leurs besoins, de leurs projets. Nous avons encore trop tendance à vouloir projeter nos PMI à l’international en partant de leurs savoir-faire et produits ; il convient d’abord de partir des besoins, des opportunités, des perspectives qu’offre l’Algérie, et donc d’une réelle connaissance du tissu productif local, de l’environnement juridique, financier et fiscal, pour ensuite, dans une seconde étape, mobiliser les acteurs économiques français.
C’est tout le sens de la démarche que je privilégie dans le cadre de ma mission, en identifiant et en dialoguant sur l’ensemble du territoire algérien très divers, avec des chefs d’entreprise, des universitaires, des responsables de clubs d’entreprise, tels que le Forum des Chefs d’Entreprise (FCE) et le Club des Entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI) avec lesquels nous avons élaboré des plans d’action autour de leurs priorités, des walis (préfets), des experts, etc., en relation permanente avec mes interlocuteurs publics, mon homologue algérien Bachir Dehimi, et bien sûr avec les équipes de notre ambassade à Alger, toujours très engagées, ainsi qu’avec Business France et la Chambre de commerce et d’Industrie algéro-française, la CCIAF.
Quelles sont les actions prioritaires à mettre en œuvre ?
À partir de mes nombreuses rencontres « de terrain », j’ai proposé à mes interlocuteurs, dès l’été 2013, trois grandes priorités, à l’interface des besoins de l’économie algérienne, des objectifs gouvernementaux et des atouts de la France.
Premièrement, élever la qualité de la formation professionnelle en Algérie, en lien avec les objectifs de développement et de diversification économique du pays. La formation professionnelle est la clé de l’emploi et de l’insertion des personnes sur le marché du travail. La formation est un levier de coopération extrêmement structurant. L’offre française est dense et expérimentée, dans les domaines concernés : formation des jeunes, des cadres intermédiaires, des techniciens, etc.
Deuxième priorité : il faut aussi développer les infrastructures technologiques et techniques d’appui aux entreprises, en favorisant les PME. Dans un pays où l’on estime que de 30 % à 40% du PIB relève de l’économie informelle, il est vital d’élever les entreprises algériennes au niveau des normes internationales. Pour répondre aux exigences croissantes des consommateurs algériens, et aussi afin de pouvoir exporter, demain, en Afrique notamment, Français et Algériens ensemble. Il s’agit ainsi de la normalisation, mais aussi de la métrologie sans laquelle il ne peut y avoir d’efficacité industrielle, de propriété intellectuelle pour défendre et promouvoir les marques algériennes existantes et demain les marques franco-algériennes, la démarche qualité.
Troisième priorité, ce sont les partenariats de coproduction : cela va de l’assistance technique à des projets algériens, jusqu’à des créations de coentreprises pour coproduire en Algérie, pour répondre aux besoins du pays puis d’exporter en ciblant en particulier l’Afrique subsaharienne. Ici, le choix du partenaire pour l’entreprise française est déterminant. Il y faut consacrer du temps et construire une relation de confiance.
En quelle manière se déploie la coopération institutionnelle ?
Ces priorités ont été actées dès décembre 2013 lors du premier Comité intergouvernemental de Haut niveau algéro-français (CIHN), co-présidé par les deux premiers ministres, Jean-Marc Ayrault et Abdelamek Sellal, et précédé en général d’un Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA), qui permet de faire un point sur les actions engagées et les perspectives concrètes de projets.
Pour la mise en œuvre de cette stratégie Paris-Alger, que je vois comme un axe structurant de la Méditerranée occidentale, nous avons établi trois priorités, trois leviers qui doivent nous permettre d’accélérer la construction d’un modèle relationnel fort et de coopération tels que nous venons de les présenter.
Coopération, car comme je l’ai déjà dit, nous avons besoin de travailler sur le long terme, parce que la concurrence mondiale aujourd’hui nous pousse à être présent sur les fondamentaux du développement d’un pays – l’Algérie est demandeur d’éducation, de formation, d’innovation, de technologie… C’est cela qui nous permet, à nous Français, de nous différencier par rapport à nos concurrents, notamment asiatiques, mais aussi américains, très intéressés par le marché algérien du numérique et de l’agriculture, par exemple, et enfin, bien sûr, des concurrents chinois – ils ont une vraie stratégie de pénétration du contient africain depuis plusieurs décennies, notamment en bâtissant des infrastructures, grâce à leurs coûts défiant toute concurrence, et leurs produits souvent de piètre qualité, comme le dénoncent de nombreux consommateurs dans ces pays, en particulier en Algérie.
Ensuite, dans le cadre de ces trois priorités, l’objectif de ma mission est de créer des cas d’exemplarité pour les coopérations… tout simplement pour démontrer qu’il est possible de travailler avec l’Algérie, et que c’est gagnant-gagnant pour les deux parties. À ce jour, nous avons initié une trentaine d’accords que nous accompagnons. Notre Ambassade à Alger est très engagée, de même que Business France et notre CCIAF.
Selon quels critères définissez-vous les cas d’exemplarité de cette coopération ?
Pour nous, les cas d’exemplarité doivent répondre à quatre critères : la recherche de l’excellence ; l’inscription du projet dans le long terme ; une illustration de la transition d’un modèle commercial vers un modèle coopératif ; l’existence d’effets induits sur l’environnement économique et social, avec notamment une montée en qualité des sous-traitants locaux, des relations avec l’université, de la création d’emplois des deux côtés de la Méditerranée, tant en France qu’en Algérie. Par exemple, s’il y a un opérateur français et un opérateur algérien qui co-investissent en Algérie, cela doit être aussi une chance de création d’emplois en France.
Comment se construit le processus de coopération ?
Concernant la priorité à la formation, il convient de chercher à mobiliser nos opérateurs un peu plus dans cette démarche consistant à passer d’un mode commercial à un mode coopératif, et à mieux prendre en compte les besoins et les attentes des Algériens. L’Algérie n’est pas seulement un marché, elle a vocation à devenir un pays émergent avec, à terme, une économie diversifiée. Il nous faut donc dépasser la relation obsolète de pays industrialisé à pays en voie de développement.
Pour la priorité de la formation professionnelle, nous avons une demi-douzaine de projets en cours. Il a fallu d’abord les identifier, comprendre les besoins et les attentes, notamment du ministère de l’Industrie, qui souhaite créer plusieurs écoles. Ensuite il a fallu mobiliser, élaborer les projets, identifier les opérateurs français susceptibles d’être intéressés, faire que les uns et les autres se rencontrent, finaliser les projets ensemble, aboutir à des protocoles d’accord, les faire signer lors du Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA) ou/et du Comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français (CIHN), et enfin faire en sorte qu’ils se mettent en œuvre. Vous voyez, c’est un travail de persévérance, sur le fond, et d’apprentissage d’un travail nécessairement collectif.
Quels cas de coopération exemplaire pouvez-vous citer ?
Il y a en plusieurs. En matière de formation qualifiante, le ministère algérien de l’Industrie et des mines (MIM) souhaitait créer quatre écoles : une pour les métiers de l’industrie, une d’économie industrielle appliquée, une dédiée au management industriel – surtout pour former les cadres supérieurs, notamment du secteur public -, et un institut de la logistique, car c’est un enjeu important pour l’Algérie.
Pour ces quatre projets d’écoles que nous avons identifiés en juillet 2013, deux mois après ma prise de fonction, j’ai mis en face quatre opérateurs français… qu’il a fallu sensibiliser et convaincre – l’Algérie, ce n’est pas toujours simple dans l’imaginaire collectif français !
Nous avons pu ainsi intéresser Mines Paris Tech pour le projet d’école des métiers de l’industrie ; l’École d’économie de Toulouse, honorée par le Prix Nobel attribué à son président Jean Tirole, en 2014, s’impliquera quant à elle dans la création de l’école d’économie industrielle appliquée ; SKEMA Business School, qui est une de nos grandes écoles sur les questions gestion des connaissances (knowledge management), s’engagera dans une école pour le management industriel ; et puis l’Avitem, l’Agence des villes et territoires méditerranéens durables localisée à Marseille, se mobilise pour contribuer à créer un Institut national de la logistique.
Les quatre protocoles d’accord ont été signés il y a deux ans. Ensuite, nous avons cerné ensemble le type d’ingénierie pédagogique, afin de faire en sorte que ces quatre projets d’écoles soient conçus ensemble, dans un même processus. Donc, c’est un comité de pilotage léger qui relie le ministère algérien de l’Industrie aux entreprises publiques et privées qui expriment leurs besoins, et aux quatre écoles françaises.
Dans une première étape, nous avons réuni à Paris en juin 2015 les responsables des établissements français et une délégation du MIM algérien en juin 2015, puis le MIM a réuni le comité de pilotage à nouveau en février 2016. Depuis, le ministère de l’Industrie, conscient qu’il ne pourrait pas gérer ces écoles efficacement en direct, a créé un groupement économique chargé de gérer les relations contractuelles avec les opérateurs français. Voilà donc où nous en sommes aujourd’hui. Mais il reste encore beaucoup à faire, il est indispensable de poursuivre ce travail collectif avec des responsabilités clairement assumées de part et d’autre, sans lequel les projets ne se feront pas.
Vous affirmez volontiers que cette coopération génère un mode de pensée tout à fait nouveau du côté des institutions algériennes…
Plus exactement, passer d’un mode de relation entre les deux pays fondé sur le commerce (import export) à un mode de relation coopératif nécessite un nouveau mode de pensée tant du côté français que du côté algérien – inscrire nos actions dans la durée – et un nouveau mode d’action fondé sur des projets coopératifs, prenant en compte tous les aspects de sa réalisation, la définition d’ un plan d’action et une évaluation permanente de son processus de mise en œuvre. En matière de projets de coproduction, nous avons maintenant quelques beaux exemples entre PMI/ETI françaises et algériennes, à travers la création de joint-ventures selon la règle du 49/51* dans des domaines très différents, comme l’agroalimentaire, la mécanique, la petite construction navale, etc.
Et votre projet de centres d’excellence en entreprise ?
C’est toujours à la demande de nos amis algériens que nous travaillons à élaborer ce que l’on appelle des centres d’excellence en entreprise.
Le concept a été mis au point par le ministère français de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR). Il consiste à aider nos entreprises françaises, quand elles s’implantent à l’international, en mettant à leur disposition un professeur « pratique » qui va animer la création d’un centre d’excellence destiné à former des salariés, des jeunes, sur les équipements de l’opérateur français. C’est lui qui, dans le pays d’accueil de l’entreprise, met en place un centre d’excellence de formation. L’opérateur français fournit ses propres équipements au centre, comme éléments gratuits pour démonstration, et forme ainsi ses salariés et ses futurs sous-traitants. C’est donc vraiment intéressant pour le pays d’accueil et pour l’entreprise française qui ainsi progressivement se fait connaître et reconnaître.
Nous avons lancé, il y a trois mois à Alger, avec le MESR un premier centre d’excellence dans l’efficience énergétique, avec le groupe français Schneider Electric et bien sûr le ministère algérien de la Formation professionnelle. Ce centre commence à rayonner vers des sites algériens classiques de formation professionnelle. L’objectif est de capitaliser sur cette expérience et en tirer des enseignements utiles pour la développer dans d’autres secteurs d’activité avec d’autres opérateurs français qui le souhaiteraient.
Vous avancez aussi via les villes jumelées…
Oui, il est important de mobiliser aussi les territoires via les collectivités territoriales dont les responsables connaissant très bien leurs tissus économiques respectifs. Aussi, je me suis rapproché de l’Association Cités Unies France (CUF) qui réunit les responsables en charge de l’international au sein des collectivités territoriales, ainsi que de Georges Morin, qui anime depuis de nombreuses années le groupe pays France-Algérie rassemblant les villes jumelées des deux pays. Nous les avons réunies, d’abord les villes françaises, dès 2014… et j’ai réalisé que si la culture notamment les occupe beaucoup, la dimension entrepreneuriale est inégalement présente dans leur pratique.
Après quoi, en octobre 2015, nous avons organisé ensemble deux journées de rencontres entre les agglomérations françaises et une délégation algérienne de grande qualité dans laquelle on trouvait des préfets, des maires, ainsi que le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.
Parmi les personnalités, il y avait notamment Régis Vallée, directeur de l’EIVP (École des ingénieurs de la Ville de Paris) qui est le principal établissement français d’ingénierie urbaine, et qui avait bien voulu répondre à notre invitation d’animer une table ronde sur la question de la ville durable et des éco-industries.
Ainsi donc, en créant les conditions de cette rencontre entre le directeur de l’EIVP et le directeur des collectivités territoriales du ministre de l’Intérieur algérien, celui-ci a exprimé le besoin de former les fonctionnaires concernés en génie urbain… On a démarré comme ça, Régis Vallée ayant considéré que l’Algérie pouvait être un facteur intéressant pour l’internationalisation de l’EIVP. Il a conduit une mission en mai dernier à Tlemcen, où le ministère de l’Intérieur veut créer cette école, car la ville bénéficie déjà d’un pôle universitaire très important dont le recteur Mohamed Djafour est très engagé dans son développement ainsi que le Wali.
Nous avons travaillé ensemble et cela a débouché sur la signature d’un mémorandum d’entente à la mi-novembre 2016 dans les locaux de l’EIVP, à l’occasion du déplacement du ministre algérien de l’Intérieur. Et avec l’aide décisive de notre ambassade à Alger. Voilà donc un exemple concret dans le domaine de la ville durable, avec près de 5 000 de fonctionnaires à former. Voilà un beau projet, ambitieux, qui s’inscrit nécessairement dans la durée et doit constituer un bel exemple de coopération entre nos deux pays.
Sommes-nous prêts à faire avec l’Algérie ce que nous avons réalisé récemment avec l’Australie ? Vendre des sous-marins, mais qui seront construits là-bas, donc avec un important transfert de technologie...
Si l’on est capable de signer ce type d’accord avec l’Australie, raison de plus pour faire de même avec l’Algérie dans différents domaines d’activité qu’elle cherche à développer (agriculture, numérique, industrie manufacturière, ville durable, EnR, etc.), car elle est pour nous un allié décisif, pour des raisons qui n’auront échappé à personne, ne serait-ce que dans la situation très incertaine que l’on connaît depuis deux ans. Et puis, l’Algérie est actuellement le pivot le plus stable du Maghreb. Rappeler ces quelques réalités, cela fait aussi partie du contexte dans lequel s’inscrit ma mission.
Quels exemples choisiriez-vous pour illustrer votre priorité sur les infrastructures technologiques et techniques ?
Face à nos compétiteurs internationaux dans la région, notamment l’Allemagne, j’ai la conviction que nous, Français, devons être en amont de la stratégie de développement de l’Algérie, et agir avec elle. De ce point de vue, sur les infrastructures techniques, je peux citer trois cas d’exemplarité qui me semblent très structurants pour notre coopération.
D’abord, à propos de la métrologie : avec le travail accompli depuis bientôt trois ans, entre le LNE français (Laboratoire national de métrologie et d’essais) et le ministère algérien de l’industrie, qui est le demandeur. Tout cela commence à prendre forme. Le rôle de l’interlocuteur français est d’aider le ministère algérien à construire le bâtiment en fonction des normes de métrologie, à fournir les équipements ainsi que des ingénieurs et des techniciens formés. C’est un projet très important qui va demander encore plusieurs années de travail et qui permettra aux entreprises localisées en Algérie – et donc aux entreprises résultant d’accords entre entreprises françaises et algériennes – de gagner en efficacité industrielle.
Un second point concerne la normalisation. Ce projet est d’autant plus important que le poids de l’économie informelle en Algérie est lourd (entre 30 et 40% du PIB suivant les publications économiques) et que le tissu d’entreprises algériennes hors économie informelle monte de plus en plus en qualité, indispensable pour à la fois répondre aux exigences croissantes et légitimes des consommateurs algériens, de la concurrence interne croissante, et de la nécessité de se développent à l’international, notamment en Afrique. C’est l’objectif de l’accord signé en 2014 entre l’AFNOR et l’IANOR, l’institut algérien de la normalisation : tout reste encore à faire ; là aussi, l’engagement doit être réel de part et d’autre, et notre rôle à moi et à mon homologue algérien de grande qualité, Bachir Dehimi, avec le MIM, est d’accompagner ces projets et de les débloquer quand un problème se pose.
Le troisième axe de travail, en matière d’infrastructures techniques, relève de la propriété intellectuelle. De plus en plus de PMI algériennes ont désormais des marques à défendre et à promouvoir ; il faut alors bien connaître son portefeuille de savoir-faire et de technologies, promouvoir des processus d’innovation dans l’entreprise et protéger les innovations. Nous avons engagé un dialogue sur cette thématique avec le MIM, le Forum des Chefs d’Entreprise (FCE), et mobilisé l’INPI qui a considéré qu’il y avait désormais un intérêt pour lui à construire une coopération dans ce domaine, en lien étroit avec l’INAPI, l’institut algérien de la propriété intellectuelle. Un accord a été signé à la fin de 2015 entre le ministre de l’industrie et des mines, M. Bouchouareb, et notre ministre de l’Economie et de l’Industrie, M. Macron.
Vous êtes allé vers le secteur privé à votre initiative, ou vous avez été missionné ?
J’ai très vite pris conscience que ma mission devait prendre aussi en compte le « secteur » privé, comme on dit en Algérie ; car dans mes nombreux déplacements, j’ai progressivement découvert, de nombreux entrepreneurs algériens, faisant un travail considérable pour développer leurs entreprises, dans la durée, en investissant en permanence dans l’outil de production, la distribution de leurs produits, leur montée en qualité, la fidélisation de leurs salariés.
C’est un tissu économique que nous sous-estimons, en France. Et ces entrepreneurs, sont très demandeurs de coopérer avec des entreprises françaises. Il y a là de nombreuses opportunités de croissance pour nos entreprises, et tout particulièrement nos PMI et ETI et ce dans tous les domaines de développement : agriculture/agroalimentaire, équipements industriels, maintenance, ingénierie industrielle, numérique, énergie, tourisme, bâtiments intelligents, services aux entreprises, hôtellerie, etc. Autant d’activités où nous avons à la fois des groupes de taille mondiale et de nombreuses PMI de qualité qui ont besoin de croître, et créant ainsi des emplois dans nos territoires, dont nombre d’entre eux sont confrontés depuis plusieurs décennies, à une désindustrialisation continue.
Combien de cas significatifs de partenariats franco-algériens de coproduction peut-on recenser à ce jour ?
Je dirais une bonne douzaine. Pour ce qui concerne les partenariats entre grands groupes, il y a l’exemple récent de CITAL. C’est la coentreprise d’Alstom et de l’EMA (Entreprise métro d’Alger), de Ferrovial et de la SNTF (Société nationale des Transports ferroviaires), qui assure désormais le montage et la maintenance de trains régionaux et intercités, sur son site d’Annaba. Renault bien sûr à Oran, qui ne cesse de grandir et de répondre aux demandes légitimes du gouvernement algérien de concourir ainsi à développer de la sous-traitance de qualité en Algérie ; il ne s’agit pas de faire des « usines tournevis », comme on disait en France dans le passé, mais vraiment de construire, dans la durée – car cela nécessite du temps -, des clusters territoriaux de compétences dans des domaines comme l’automobile, le ferroviaire, l’agroalimentaire, etc.
Vous connaissez sûrement le projet en cours d’élaboration de PSA, qui est de construire une usine Citroën à Oued Tlelat près d’Oran, en partenariat avec notamment le groupe privé algérien Condor. J’espère bien sûr qu’il va aboutir et se concrétiser, permettant aussi de mobiliser des équipementiers français et de créer des centaines d’emplois localement. Il y a aussi Lafargue qui a signé un accord important avec GICA (Groupe industriel des ciments d’Algérie), accord qui comporte l’apport technologique sur de nouveaux matériaux.
Un bel exemple aussi, c’est celui du groupe coopératif Avril… L’histoire commence il y a deux ans. Je rencontre leurs responsables confrontés à la nécessité pour l’Algérie de freiner le flot des importations et de favoriser le développement de productions locales. Progressivement, nos échanges ont vu leurs positions évoluer, prendre en compte la stratégie du gouvernement algérien et travailler avec beaucoup de professionnalisme à passer d’une logique d’exportation à une stratégie d’implantation locale, avec des partenaires locaux.
Après études, c’est ce qu’ils ont fait. Ils ont engagé le processus d’élaboration d’un partenariat, avec leur importateur le groupe Djadi, qui a aussi un métier d’industriel et de distributeur, que j’ai rencontré avant les fêtes à Blida, avec lequel ils ont décidé, en avril 2016, de créer une usine de sauces condimentaires, sous la marque Lesieur. Le projet se met bien en place, avec une équipe algérienne de grande qualité. De même avec le groupe privé SIM, pour développer une usine de production de nutrition animale : là-aussi une belle entreprise algérienne qui ne cesse de se développer. Et puis aussi ce cas exemplaire d’une toute petite startup française de la région lyonnaise, IP3 Group, qui a inventé des machines à faire des palettes en carton et construit un partenariat avec le groupe algérien Palania (Batouche), qui démarre très bien et se traduit par des créations d’emplois en France. Un projet que la Mission a accompagné durant tout le processus.
Vous voyez, ce sont des cas exemplaires de passage d’une logique import export à une logique de co-investissement et de coproduction.
Ce désir assez récent, affiché par les Algériens, de coopérer avec les Français vous paraît-il sincère et durable ?
Pour les PME du secteur privé qui ne sont pas dans le secteur informel, oui, absolument ! Simplement il faut bien les cibler.
Quand je vous parle de SIM et de DJADI, nous pourrions citer aussi VENUS dans les cosmétiques, BENAMOR, le groupe SAHRAOUI ou BATOUCHE par exemple dans l’agroalimentaire, Général Emballage, CEVITAL bien sûr dans de nombreux secteurs d’activité, et bien d’autres, – ils me pardonneront de ne pas tous les citer ce sont typiquement des entreprises privées qui ont été créées il y a parfois plusieurs décennies par un père dont les enfants aujourd’hui prennent la suite. C’est comme nos PME. Et ils financent leurs projets sur fonds propres, car ils ont su acquérir des positions de numéro un sur leurs marchés… Ils iront encore plus loin s’ils jouent la qualité, tant sur leur marché domestique qu’à l’international : aujourd’hui, le consommateur algérien a la même exigence que le français – et ils nous connaissent parfois mieux que nous nous connaissons ! Je rencontre aussi aux quatre coins du territoire algérien une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs algériens, très actifs, par exemple dans le numérique ou les services aux entreprises, et notamment de plus en plus de femmes qui s’engagent dans l’entrepreneuriat.
Que conseillez-vous à l’entrepreneur français intéressé par cette démarche de coproduction avec un partenaire algérien ?
Tout d’abord, l’entrepreneur français doit bien se garder de se faire entraîner dans le secteur informel, par naïveté et ignorance.
Confronté à un pays où l’économie informelle est importante, il a une forte probabilité sur deux de tomber sur un intermédiaire pas très rigoureux, comme dans de nombreux pays.
Vous nous dites ce qu’il ne faut pas faire, d’accord ! Mais que préconisez-vous ? Faut-il toujours passer par les filières classiques des chambres de commerce ?
La première chose est de prendre contact avec notre CCIAF à Alger. Bien sûr, ils connaissent bien la réglementation, la sphère administrative et le marché algérien. C’est une source d’information technique sur comment aller sur le marché algérien, voire s’implanter.
Il y a aussi Business France Algérie, dont l’équipe est très engagée, favorise des rencontres entre entreprises des deux pays et organise régulièrement de nombreuses rencontres ciblées de plus en plus sur des thématiques précises afin que les entrepreneurs des deux pays ne perdent pas de temps et puissent aussi trouver plus aisément des partenaires.
Il faut prendre le temps nécessaire, et donc prévoir une trésorerie de quelques mois d’avance, afin d’aller à la rencontre de ces organismes, de rencontrer d’autres opérateurs français, qui ont l’expérience de l’Algérie, etc. Ce n’est pas parce que nous parlons une langue commune, que tout se fait automatiquement ! Il faut gagner la confiance de ses futurs partenaires.
Ma mission a aussi pour rôle de rencontrer les entreprises françaises ; je vais d’ailleurs souvent à leur rencontre, pour ne citer que ces derniers mois, à Dunkerque, Lille, Bordeaux, Grenoble, Montpellier, Marseille, etc., autant de villes qui sont jumelées avec des villes algériennes.
Monsieur Levet, vous êtes en train de dire que le Haut Responsable, le haut fonctionnaire que vous êtes peut être saisi en direct par un patron de PME ? Mais comment vous trouve-t-il ?
Mais, avec Internet ! En tapant par exemple Coopération économique France-Algérie…
La soi-disant « diplomatie économique » que l’on aurait (re)découverte au cours de ce quinquennat vous a-t-elle été d’un quelconque secours pour accomplir votre mission ?
Nous avons cité certains des organismes qui travaillent à aider les entreprises françaises ; les hommes et les femmes y ont un fort engagement. Il faut continuer à faire évoluer nos modes de pensée, nos modes d’organisation pour être plus à l’écoute des pays où nous cherchons à nous implanter davantage ; multiplier les cas d’exemplarité, les faire connaître en France dans nos différents territoires, dans nos pôles de compétitivité qui regroupent des milliers de nos PME innovantes, dans nos universités, dans les clubs d’entreprises, et aussi via les médias.
Je suis sur le terrain, je recherche sans cesse le contact avec les opérateurs, j’évalue avec eux leurs besoins, j’essaie d’identifier les possibilités de coopérations d’exemplarité, je m’efforce d’établir des relations de confiance. Et pour cela je prends le temps qu’il faut. Les dirigeants d’entreprise me disent beaucoup de choses. C’est ça la relation de confiance… les gens parlent du fond du cœur quand ils sentent que vous êtes là pour être à leur écoute et avancer avec eux. Il y a une attente de France extrêmement forte. Et ils espèrent aussi que l’on parle de ce qu’ils réussissent. Voilà pourquoi, il faut être sur le terrain, tout en gardant toujours le cap, nos priorités, l’accompagnement des projets, leur évaluation, et ne pas se laisser mener par les aléas conjoncturels, de quelque nature qu’ils soient !
Vous accomplissez un travail d’acculturation, et en même temps très pragmatique, pas à pas, pour aboutir à des résultats concrets… Ne pourrait-on pas dupliquer votre mission, créer un « corps d’ambassadeurs itinérants de la France entrepreneuriale », comme vous l’êtes de fait ? C’est stupéfiant que vous soyez le seul avec ce profil, non ?
Non, je ne suis pas le seul ; mais l’Algérie est un bon exemple de ce que nous essayons collectivement de faire ; j’essaie simplement de remplir la mission qui m’a été donnée par notre gouvernement, en lien avec les opérateurs français, et les différents ministères, bien engagés dans mon comité de pilotage propre à ma mission.
Et si je devais résumer d’une phrase les préceptes qui inspirent mon action, je dirais que s’il faut continuer à chercher des clients, c’est bien mieux lorsqu’on trouve des partenaires. C’est particulièrement vrai avec l’Algérie, que pour de multiples raisons nous, Français, ne saurions considérer comme un simple marché. Ce qui est fondamental dans tout cela, c’est bien sûr la confiance partagée. Les Algériens nous connaissent plus que nous croyons les connaître. Soyons à la hauteur des enjeux, en préparant l’avenir un peu chaque jour.
Entretien réalisé par Alfred Mignot.