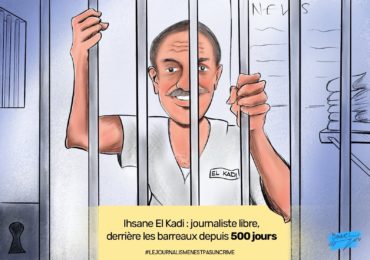Ce dossier de publications entre dans le cadre des activités du réseau de médias indépendants dans le monde arabe. Il concerne l’usage de la langue arabe de manière générale.
Mohamed Galal et Naila Mansour (journalistes Al Jumhuriya )
Note à tous les lecteurs qui pourraient être tentés de croire que les exercices linguistiques délirants que nous réalisons consistent en une analyse, une déconstruction, ou qu’il s’agit de philosophie et de politique ; nous nous devons de vous prévenir que la langue séduit par sa fluidité, et qu’il convient de veiller à ne pas en abuser ni à en dépasser les limites. Bien que trouver, énumérer et catégoriser les mots ne soit pas une pensée, il est indispensable de relever les mots blessants afin de réfléchir à la violence, y compris à la violence politique. Notre belle langue arabe, par son riche éventail lexical propice à la créativité, possèderait tout le potentiel pour blesser profondément des sujets dans certains contextes politiques.
Nouhibou signifie littéralement « nous exhortons », et porte le sens implicite d’un ordre menaçant et urgent. Il s’agit d’un terme effrayant, adressé par une personne terrifiante à des citoyens apeurés, les invitant à craindre quelque chose de terrorisant qui pourrait avoir des conséquences effrayantes au-delà de leurs craintes quotidiennes omniprésentes : « Le ministère de l’Intérieur « exhorte » les citoyens à coopérer avec les services de sécurité pour préserver la paix et la sécurité intérieures ». Un responsable militaire déclare : « Le ministère de l’Intérieur « exhorte » les citoyens à respecter les réglementations et les lois, à ne pas utiliser de haut-parleurs, et à ne pas diffuser de chansons, de slogans, ni de musique pouvant perturber le confort de la population ».
Il est surprenant que certains termes et certaines expressions de la langue arabe, tels que nouhibou soient étroitement associés au régime d’Assad et récurrents dans ses déclarations officielles, imposant sa forte présence auprès des Syriens. Ces termes et expressions reviennent régulièrement dans les déclarations et les entrevues des hauts responsables syriens à la presse. À croire que le régime fournit à ses responsables un dictionnaire d’expressions propres au régime, accompagné d’un guide d’utilisation sur les termes à utiliser ou à éviter, afin d’étouffer toute créativité ou innovation dans leurs déclarations. Il est plus surprenant encore de constater que lorsque des individus extérieurs au régime ont recours à ces expressions, on tend à penser qu’ils les ont employés par erreur, ou qu’ils sont probablement affiliés au régime d’une manière ou d’une autre. En effet, ces prouesses linguistiques requièrent une longue formation à la lutte.
Danger imminent
Ce terme renvoie à l’image d’une personne au visage sérieux en habit officiel qui adresse des réprimandes menaçantes au citoyen. Il s’exprime d’une voix forte, avec éloquence et à un rythme soutenu et mesuré. Le citoyen se sent constamment « exhorté », mouhayyab bihi, il doit être « effrayé » – ressentir du tahayyob – autant que possible. S’il n’est pas dans la crainte, il est tenu de prétendre l’être afin de ne pas porter atteinte au « prestige », hayba, de l’État, ce qui pourrait avoir des conséquences indésirables. Le citoyen doit toujours avoir le sentiment d’avoir mal agi, sans savoir en quoi. Les « effrayés » doivent se résigner à vivre dans un monde inférieur en dehors des murs de l’État, car s’approcher de ces murs constituerait une atteinte au « prestige » de l’État. Plus le recours à « l’exhortation », augmente et varie, plus les « effrayés » s’éloignent de ces murs et les craignent.
Nouhibou vient du verbe haaba, « avoir peur » ou « craindre ». Bien qu’il s’agisse de verbes traduisant un état interne et exprimant des sentiments involontaires, rien n’est involontaire dans le régime d’Assad, pas même l’amour, la haine et la peur. Les exhortations répétées du régime à « être intimidé », at-tahayyob, ont créé au fil du temps chez « les effrayés » le réflexe conditionné de percevoir un danger imminent. Le verbe nouhibou a toujours eu des conséquences désastreuses sur un nombre limité ou élevé d’individus. Il ne s’agit jamais d’une coïncidence : c’est là la fonction réelle de ce verbe ; les « effrayés » ne doivent pas avoir le choix de « craindre » ou de « ne pas craindre » comme ils le souhaitent. Tout comme les Syriens doivent décider de « craindre » le régime, ils doivent aussi décider de « ne pas craindre » les opposants au régime, ce qui constitue une incohérence dans le « prestige » de l’État. Ils doivent décider qu’ils aiment et détestent au gré des caprices de l’État, comme le fait Winston dans les dernières pages de 1984, lorsqu’il se résigne à aimer Big Brother et remet en question les sentiments qu’il a eus son égard tout au long du roman.
Le terme mouhib, toujours dérivé de la même racine, désigne d’une part un appel à « craindre » quelque chose « d’effrayant », et d’autre part le grade militaire de maréchal, que Saddam Hussein a hérité de ses prédécesseurs, après avoir rendu son « prestige » sacré dans le cœur des Irakiens, contrairement à Hafez al-Assad, qui était effrayant et seul détenteur du grade de lieutenant général en Syrie. On qualifie de mouhiba, « solennelles », les scènes de tristesse ou de deuil, comme le furent les funérailles de Hafez al-Assad, et de son fils Bassel avant lui, scènes lors desquelles chacun pleurait et se lamentait de son mieux.
Il existe également le terme de mahyoub, « charismatique », qui s’applique à Qusay, adjoint du chef des renseignements de l’armée de l’air, et l’un des treize responsables du régime d’Assad sur la liste de la honte américaine, ainsi qu’à Ali, brigadier et porte-parole de l’armée du régime, que l’on a l’habitude de voir « exhorter » les citoyens, l’un de ses passe-temps favoris. Samira Toufiq évoque dans l’une de ses chansons un jeune homme qui est lui également mahyoub. Son nom n’est pas mentionné ici simplement en raison de la similitude des noms. Cette description est une condition sine qua non à la perfection de la personnalité de l’homme oriental dont parle Toufiq, ce même homme qui a construit ce régime à son image – violent, en colère, émotif et sûr de ses opinions, et bien sûr « charismatique ».
Catastrophe attendue
Nouhibou, hayba, haaba, mahyoub, autant de termes qui expriment la mentalité hiérarchique profondément ancrée chez les Syriens depuis des décennies, bien avant le régime Assad, qui a à son tour rendu cette mentalité sacrée dès son arrivée au pouvoir et en a fait l’un des piliers de son autorité. Cette situation implique que tout le monde soit « effrayé » par tout le monde. Les citoyens doivent « craindre » l’État, la ville doit « craindre » la campagne et les confessions doivent « se craindre » mutuellement. L’employé doit « craindre » son responsable et ce dernier doit « craindre » le responsable de la branche du parti, qui lui-même doit « craindre » l’élément de sécurité. Le régime n’a pas eu beaucoup de difficultés à généraliser cet état de « crainte », car une société dans laquelle la femme « craint » son mari, les enfants craignent leurs parents, et les frères craignent leur frère aîné, est propice au passage à un stade plus complexe et sophistiqué de la « crainte ». Cette situation s’est reproduite sous le régime d’Assad de manière plus sophistiquée et compliquée, et l’utilisation excessive du terme « hayba » s’est propagée, de même que les termes pompeux de glorification et les comportements qui garantissent la préservation de cette mentalité, tels que le port et l’utilisation d’armes lors d’événements sociaux et d’autres pratiques dissimulant les défaites, les échecs et les déceptions. Les Syriens les plus faibles et vulnérables, par exemple, ont recours au dialecte sahélien, qui leur donne davantage de « charisme »; Ils écoutent également les chansons de Ali al-Deek, ou encore de Wafik Habib, d’une grande popularité auprès des icônes du régime, ce qui leur procure également du charisme.
uhba, ici employé dans une expression qui signifie « sur le qui-vive », est également dérivé de la même racine. La Syrie est toujours sur le qui-vive, comme s’il s’agissait d’un état normal pour ce régime mouta’ahhib, toujours prêt. L’armée et les forces de sécurité sont toujours sur le qui-vive, tout comme doivent l’être les citoyens, afin de surmonter le tournant historique que nous traversons depuis très longtemps. L’état de « qui-vive » fait partie intégrante du tempérament des Syriens : ils sont toujours prêts à survivre et à établir des plans B, C et D à mettre en exécution lorsque la catastrophe attendue est là. L’état de « qui-vive » sous-entend l’arrivée d’un événement relativement soudain qui causera une interruption spatio-temporelle exceptionnelle dans la vie des Syriens, interruption durable et continue face à laquelle on retrouvera une éternité indubitable : Assad pour toujours.
L’État, père de tous
Le « prestige », hayba, est donc un dérivé du verbe nouhibou, à moins qu’il ne s’agisse de l’inverse : pour cet État appelé Syrie et pour d’autres états similaires, le « prestige » est beaucoup plus important que l’état en soi ; l’on comprend ainsi ce qui a poussé Bachar Assad à dire un jour qu’il n’avait aucun problème avec les manifestations, mais bien avec ceux qui les filment et les photographient pour les diffuser hors du pays, violant ainsi le « prestige » de l’État, qui n’a été réduit à néant ni par la passation du pouvoir par héritage, ni par la répartition des biens de l’État parmi les parents et l’entourage.
« L’atteinte au prestige » de l’État constituait l’un des principaux moteurs des partisans du régime ; ces derniers donnaient le droit à l’État d’opprimer ceux qui lui désobéissaient, de la même manière qu’ils donnaient au père le droit de discipliner son fils qui ne respectait pas la famille et ses règles. Tout comme le père, l’État sait mieux que « ses fils » ce qui est dans leur intérêt, et peut recourir à la violence pour les éduquer. Les problèmes internes doivent rester privés afin de ne pas porter atteinte au « prestige » de la famille. Il incombe au père de prendre seul les décisions au sein de la famille, sans que personne ne puisse s’y opposer, même si la décision implique le mariage de l’un de ses enfants, leur choix de carrière, ou d’autres décisions personnelles. L’image du chef, père de tous, doit orner les murs du pays, de même que l’image du chef de famille orne ceux du foyer ; C’est là que réside la folie du langage de la tyrannie : le signifiant est effrayant, mais il repose sur des référents très proches : la famille, le père, les proches, et la communauté. Cette confusion schizophrénique entre l’État et toute chose provoque notre folie et celle d’autrui.
La plupart des Syriens détenus depuis le début de la révolution en 2011 ont été arrêtés pour atteinte au « prestige » de l’État, officiellement incorporée aux textes juridiques comme délit et reconnue comme tel lors des procès de citoyens devant divers tribunaux. La situation est opprimante notamment du fait de l’incertitude concernant ce qui est considéré comme une atteinte au prestige de l’État, tout est possible et ambigu, afin de pouvoir porter aisément des accusations ; l’ambiguïté paralyse les mouvements et le sens de l’initiative. Elle propage la peur et la terreur. L’ambiguïté est ce qu’il y a de plus « terrifiant ». Une publication sur Facebook, une inscription murale, un mot qui vous échappe, une plainte contre la corruption, l’injustice, une revendication de droits, une dispute avec des employés de l’État, une opposition à une loi ou à une nomination : tout cela suffit à porter atteinte au « prestige » d’un État dont les frontières ont été violées par plusieurs pays et armées.
Le fils déshonorant
Dans une autre tentative désespérée de démystifier la crainte du prestige, nous nous sommes naïvement demandé : les personnes accusées de « porter atteinte au prestige de l’État » pour avoir par exemple « affaibli la détermination de la nation », « affaibli la confiance en l’économie nationale », « divisé les éléments de la nation », « trahi l’État », « traité avec des entités étrangères », ces personnes sont-elles à l’abri de blessures émotionnelles ? Nombre d’entre elles ont par la suite ri des accusations portées contre elles, ayant le sentiment de vivre une parodie, mais n’étaient-elles en réalité pas blessées ? Ces personnes peuvent toujours rire de la gravité de la situation, mais ce recours au cynisme trahira forcément leurs blessures. Pourquoi sommes-nous blessés lorsque accusés de porter atteinte au prestige de l’État et de la nation, ou de provoquer des conflits sectaires ?
Nous avons toutefois oublié de proposer une première définition linguistique du terme hayba. Comment le définir ? Nous le percevons comme un concept esthétique ; il désigne la stature mêlée à l’inspiration du respect et au charme, à laquelle s’ajoute une touche de sobriété… Et après ? Comparons les équivalents au mot hayba dans d’autres langues, ou du moins les langues méditerranéennes que nous connaissons, et dont la structure patriarcale est similaire. Il n’existe cependant aucun terme qui rende justice à la hayba arabe, qui mêle les notions de statut, de pouvoir, de dignité, de sobriété et de fierté, ainsi qu’un élément esthétique indéfinissable. Cela s’applique aux femmes, mais surtout aux hommes, de sorte que le « prestige » aille de pair avec la virilité. Cette image de hayba s’applique parfaitement à Taym Hassan, qui joue le personnage de Cheikh el-jabal dans la série al-hayba, série en trois saisons qui a connu un grand succès. Cette série se déroule dans un village nommé al-hayba, où le protagoniste cultive et vend du cannabis. Il dirige un gang qui n’obéit ni à l’État, ni à la loi. Malgré cela, il a séduit les téléspectateurs par sa hayba, qui ici désigne son charisme, ainsi que par sa beauté, son humanité et son bon coeur. Il est en conflit avec l’État libanais ; en effet, le prestige de l’État est menacé par celui de Cheikh el-jabal. La hayba est un élément esthétique artificiel, qui n’est ni naturel ni pratique, et la loi syrienne punit ceux qui essaient d’y porter atteinte. Il s’agit d’un élément patriarcal ; toute personne accusée d’y toucher ressentira la honte de la désobéissance. La blessure causée par l’accusation de « l’atteinte au « prestige » de l’État » réside dans le sentiment de honte et de culpabilité profonde. Les expressions émotionnelles et esthétiques utilisées à tort dans un contexte juridique effacent la distance entre l’État, la nation, la patrie d’un part, et le chef d’autre part. La relation devient alors incestueuse. Les condamnées violent le corps du chef, père de tous, qu’ils adorent sans aucun respect de la distance que garantit un langage juridique froid, dépourvu de tout sentiment et de toute émotion. Lorsqu’un condamné est violé dans le cadre de cette relation, il se sent coupable, comme toute personne violée dont la vie privée a été violée. En réalité, les méthodes de torture utilisées dans les prisons syriennes présentent une particularité qui leur est propre, une particularité qui n’est pas la brutalité, que l’on retrouve dans beaucoup de comportements humains. Il s’agit de la relation intime avec le corps du détenu et de sa possession, à savoir non seulement les viols sexuels, mais aussi l’insistance sur la possession du corps du détenu et sur la discipline, comme s’il s’agissait d’un fils déshonorant. Nulle besoin d’expliquer davantage.
Lors de la révolution syrienne de 2011, on a essayé de remplacer « le prestige » par « la dignité », une tentative de renverser le « prestige » de l’État ancré en eux et, avant cela, le « prestige » de leurs communautés et des individus qui nous entourent. Ils ont ainsi tué le régime, géant qui s’est effondré sous leurs yeux ; le temps était venu d’un changement social et politique, avant que l’on ne perde de contrôle, pour en arriver là où nous sommes aujourd’hui. À présent, toutes les arrestations, les intimidations et les assassinats sous la torture perpétrés par le régime dans les zones qu’il contrôle, ainsi que les bombardements barbares dans les zones qu’il ne contrôle pas, constituent une tentative de reconquérir son « prestige », condition sine qua non à sa survie.