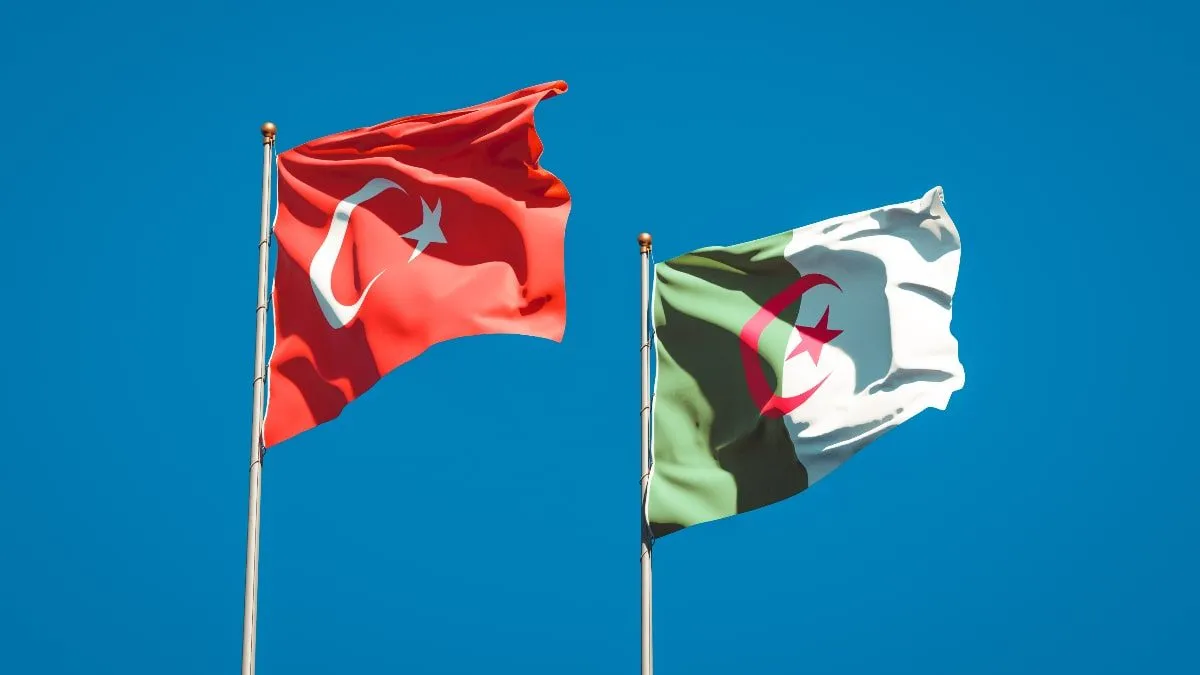Le plan d’action présenté par le gouvernement Ouyahia ne précise pas la nouvelle trajectoire budgétaire retenue « en vue de la restauration de l’équilibre budgétaire dans un délai de cinq années », déplore l’économiste Alexandre Kateb, membre de la task-force constituée auprès de l’ex-Premier ministre Abdelmalek Sellal.
Dans une analyse du plan d’actions du Gouvernement et l’introduction des financements alternatifs proposés par Ahmed Ouyahia , l’économiste Alexandre Kateb estime que « la crédibilité d’une trajectoire de redressement budgétaire, surtout lorsque le déficit est financé par de la création monétaire, repose en premier lieu sur la transparence et la communication tant auprès de la population et des opérateurs économiques et financiers domestiques, qu’auprès des partenaires étrangers ».
Selon lui, il est « impératif d’expliciter cette nouvelle feuille de route budgétaire », à l’occasion du projet de loi de finances 2018 « et d’annoncer le volume total de la dette publique supplémentaire qui sera acquis par la Banque d’Algérie ». Aussi, ajoute-t-il, « il faudra également expliciter le mécanisme de suivi et de pilotage de cette trajectoire de redressement budgétaire, qui ne pourra pas être réalisé en circuit fermé au sein de l’administration, et qui devra rendre compte devant le Parlement et devant les citoyens dans leur ensemble, à travers une communication semestrielle, voire trimestrielle, des progrès réalisés, ainsi que des risques de déviation par rapport au cap fixé, à travers l’élaboration et la présentation de scénarios alternatifs et de mesures de prévention des risques identifiés.
Pour l’économiste, un problème d’incohérence temporelle se pose dès lors que le cycle politique actuel s’achève en 2019. Le gouvernement actuel va, en pratique, transmettre la « patate chaude » à son successeur qui sera désigné par le Président élu en 2019. Qu’est ce qui va obliger le Gouvernement actuel à faire preuve de discipline budgétaire, sachant qu’il n’aura pas à rendre de comptes dans cinq ans de son action et de sa gestion de ces « financements non conventionnels » ? s’interroge-t-il.
Quelles capacités pour les banques publiques ?
Analysant, le recours durant cette « période transitoire » de cinq ans aux « financements non conventionnels », Alexandre Kateb s’interroge également sur la capacité des banques publiques à absorber la nouvelle dette publique qui sera engendrée, « sans que cela ne crée un effet d’éviction significatif, en obérant leur capacité, déjà contrainte, à prêter aux entreprises, et notamment aux entreprises privées ».
« Le pari du gouvernement est que le ballon d’oxygène dont il bénéficiera auprès de la Banque d’Algérie permettra de soutenir la croissance économique et, in fine, de desserrer la contrainte de liquidité qui pèse sur les banques. Le gouvernement compte aussi sur le maintien par la Banque centrale de son taux de réescompte à son niveau actuel de 3,5%. En effet, la Banque d’Algérie étant captive dans ce scénario de « fiscal dominance » exacerbée, comme on dit en jargon d’économiste, ne pourra augmenter ses taux d’intérêt sans contrevenir à son objectif assigné de soutien au Trésor, ni sans compromettre ses propres équilibres financiers. Si elle augmentait ses taux d’intérêt, cela se traduirait en effet immédiatement par des pertes en valeur sur le portefeuille de titres du Trésor qu’elle détient, des pertes qui se matérialiseront lorsqu’elle voudra céder ces titres sur le marché secondaire », a-t-il analysé. Et de préciser que la Banque d’Algérie conserve pour mission centrale le maintien de la stabilité des prix. « Cette mission, explique-t-il, exigerait une hausse graduelle des taux d’intérêt, pour contrer l’accumulation des pressions inflationnistes issues du financement monétaire du Trésor, et pour éviter que ces pressions ne dégénèrent en hyperinflation ».
Le risque inflationniste
Pour lui, le financement du déficit budgétaire nécessitera, en outre, la reprise de la politique de dépréciation graduelle du dinar vis-à-vis des devises étrangères qui avait été engagée en 2015, avant d’être stoppée en 2016. « La dépréciation du change est une des solutions les plus efficaces, à la fois pour réduire la facture des importations, en renchérissant leur coût en dinars, et pour réduire le déficit budgétaire en gonflant la contrepartie en dinars des recettes pétrolières libellées en dollars. Or, cette dépréciation, en réalité une dévaluation à feu lent qui ne dit pas son nom (« stealth devaluation »), aura un effet inflationniste inévitable qui s’ajoutera à celui généré par la monétisation du déficit public », analyse-t-il.
Alexandre Kateb estime ainsi que le risque inflationniste généré par le recours à ce financement monétaire du déficit public, et par le recyclage des liquidités ainsi créées, y compris dans la sphère informelle sous forme de monnaie fiduciaire, est bien réel. Et l’impasse financière et budgétaire dans laquelle « se trouve aujourd’hui l’Algérie n’est donc pas liée uniquement aux conséquences directes de la crise pétrolière ». « L’absence de programmation budgétaire pluriannuelle – jusqu’à l’adoption tardive de la feuille de route budgétaire 2016-2019 en juillet 2016 -, et l’absence d’évaluation périodique de l’efficacité et de l’efficience des dépenses d’équipement engagées, ainsi que le creusement imprudent d’un déficit structurel conséquent – hors recettes des hydrocarbures-, atteignant jusqu’à -38% du PIB hors hydrocarbures en 2014 (cet indicateur technique est très souvent utilisé dans les pays exportateurs de pétrole), sont autant de facteurs qui ont précipité la crise des finances publiques », soutient-il.