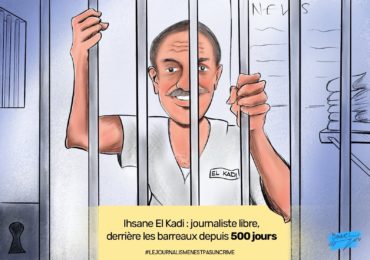Alors que l’Algérie vit en marge de la Constitution, Mme Fatiha Benabou, professeur de droit constitutionnel, lance un débat sur les mérites comparés des constitutions de 1989 et 1976.
Fatiha Benabou, professeur de droit constitutionnel, n’aime pas la constitution de 1989, adoptée sous Chadli Bendjedid. Elle lui préfère visiblement celle de 1996, dont les auteurs ont fait preuve de « génie ».
Même si elle reconnait que le texte de 1989 « marque, de manière explicite, la rupture » avec l’ancien ordre constitutionnel, elle lui reproche d’avoir « clandestinement » supprimé « l’option socialiste » contenue dans la constitution de 1976, et d’avoir fait disparaitre « subrepticement » le parti unique. Comment des dispositions contenues dans un texte rendu public, débattu, soumis à référendum, même dans des conditions qu’on peut contester, comment ces dispositions peuvent être clandestines ou adoptées « subrepticement » ?
Elle reproche également aux auteurs du texte de 1989 « l’intention inavouée » de « changer le mode de légitimation et d’accès au pouvoir », par le biais de « la substitution progressive du multipartisme au monopartisme du FLN ». Remplacer le système du parti unique par le multipartisme dans une constitution soumise à référendum relèverait donc d’une « intention inavouée » !
Trois formules, « subrepticement », « clandestinement », et « intentions inavouées », marquent cette défiance de Mme Benabou envers la constitution de 1989 qui, selon elle, « était grosse d’une grave crise politique » et « portait, en son sein, par ses contradictions, les germes des convulsions qui secoueront l’Algérie ».
Préjugés
Si elle admet que la constitution de 1989 introduit une « d’ouverture politique », Mme Benabou estime que la démarche a été aussitôt torpillée par la loi sur les partis adoptées sous le gouvernement de M. Kasdi Merbah en juillet 1989, laquelle introduit « les ingrédients d’une décrédibilisation de ce pluralisme ». Elle rappelle qu’il « suffisait 15 membres pour bénéficier d’un récépissé d’enregistrement ». Le résultat fut un « multipartisme débridé », avec « une forte fragmentation du champ politique algérien et son émiettement en une multitude de partis politiques, très souvent, sans réelle base sociale ».
Combien faut-il de signatures pour qu’un parti soit crédible ? vingt ? Cent ? Mille ? Appartenait-il au pouvoir de l’époque d’organiser la société et d’encadrer les nouveaux partis, alors qu’il était fortement contesté, comme en attestent les drames d’octobre 1988 ?
En fait, la constitutionnaliste fait abstraction de la conjoncture de l’époque. Le président Chadli Bendjedid, le gouvernement Merbah, ainsi que les rédacteurs de la constitution, tous issus du FLN, étaient sous forte pression. Il leur était reproché de vouloir verrouiller le jeu au profit de leur parti. Ils étaient donc contraints de lâcher du lest, de faire preuve d’ouverture, en facilitant l’émergence de forces nouvelles susceptibles de constituer des alternatives au FLN.
Un texte complexe
La complexité de la constitution de 1989 sur les rapports entre le président de la république et le gouvernement est réelle, et elle est soulignée à juste titre par Mme Benabou, qui en tire toutefois une conclusion totalement décalée.
« Ces équivoques se sont soldées par une instabilité ministérielle et une hécatombe de chefs de gouvernement », écrit-elle. Ce qui est erroné : l’instabilité a précisément pour origine la non application de la constitution, dans son esprit plus que dans sa lettre, quand Chadli Bendjedid a poussé Kasdi Merbah vers la sortie en septembre 1989, et quand il a accepté la démission de Mouloud Hamrouche en juin 1991, sous la poussée de la rue, alors que le parlement n’était hostile ni à l’un ni à l’autre.
Système déclaratif et ordre policier
En fait, sur les partis comme sur les associations et la presse, le pouvoir de l’époque a opté pour un choix fondamental : le système déclaratif, propre aux systèmes libéraux, même si Mme Benabou «hésite à parler de changement vers une Constitution libérale ». Dans ce modèle libéral, le citoyen a tous les droits, à charge pour l’administration de prouver qu’il a enfreint la loi.
A l’inverse, Mme Benabou semble avoir une préférence pour un système où le contrôle se fait à priori. C’est à l’administration, voire aux services de sécurité, de vérifier si tel citoyen, tel groupe, peut accéder au privilège de créer un parti, de lancer un journal ou d’accéder au gouvernement.
Elle trouve du « génie » dans la constitution de 1996, qui ne veut « pas abandonner le sort de la démocratie aux hasards issus des flux majoritaires ». Il s’agissait de « rendre moins aléatoires les résultats des élections en filtrant en amont les partis politiques susceptibles » de remporter les élections. En langage clair, cela suppose que seuls les partis bénéficiant des faveurs du pouvoir du moment peuvent gouverner, et d’éviter que le peuple, qui peut mal voter, envoie au parlement une majorité indésirable.
Pour éviter tout risque de dérapage, « l’Assemblée populaire nationale, susceptible de devenir démagogique, se verra lestée d’une seconde Chambre, dite de réflexion, qui aura, de surcroît, un pouvoir de blocage grâce à un tiers présidentiel nommé ».
C’est clairement affirmé, et assumé : les élus du peuple peuvent voter, jouer, mais s’ils se trompent, une minorité de blocage désignée par le président de la République et installée au Sénat est là pour calmer leurs « ardeurs ». Les élites éclairées ont le droit de refuser le choix de la masse. Ce n’est pas la suprématie de la norme constitutionnelle qui est recherchée. C’est plutôt le droit des chefs de contrôler la plèbe qui doit primer. Ce qui montre à la fois l’utilité et la futilité d’un débat sur la constitution dans un pays qui vit en marge des textes constitutionnels.