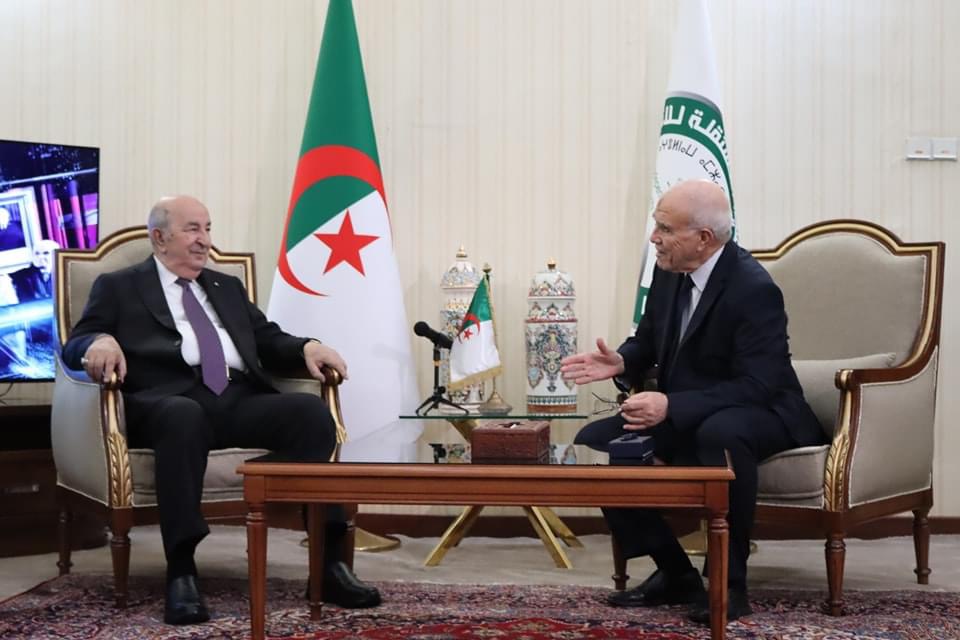De dérive en dérapage, l’économie algérienne a accumulé les distorsions. Ce qui a débouché sur un modèle de gestion inextricable.
Les entreprises publiques représentent 20% seulement de l’économie algérienne hors hydrocarbures, mais elles absorbent 60% des crédits, selon l’économiste Abdelhak Lamiri, patron de l’Insim (Institut Supérieur de management). La part du secteur privé dans les crédits atteint 45%, bien qu’il assure 78% de la production. Autant d’indices qui confirment que l’économie algérienne est constituée d’un ensemble d’incohérences résultant d’un modèle de gestion décalé.
Une étude réalisée au profit du ministère de l’enseignement supérieur, basée sur 110 paramètres, a révélé que l’investisseur algérien consacré 30% de ressources en moins aux machines productives, et 80% de plus aux actifs improductifs, comme les terrains, les hangars, les moyens de transports, etc. Résultat: l’entreprise algérienne n’est même pas compétitive par rapport aux entreprises africaines, et l’efficacité de l’investissement demeure très faible.
Mais contrairement à une idée répandue, M. Lamiri estime qu’il y a, certes, « des différences » entre la gestion des entreprises privées et celle du secteur public en Algérie, mais « elles ne sont pas énormes ».
Pas assez de financements dans la formation
Abdelhak Lamiri déplore aussi « qu’on n’aide pas assez les entreprises qui réussissent ». Selon lui, le gouvernement doit éliminer la distinction entre public et privé, au profit d’une autre distinction, celle entre « les entreprises qui réussissent et celles qui échouent ». Il note qu’à ressources égales, les entreprises privées sont « mieux gérées ». Leur part est passée de 18% du PIB hors hydrocarbures en 1990 à 78% aujourd’hui, alors qu’elles ont « beaucoup moins de ressources ». « A ressource égales, le privé se développe plus rapidement », dit-il.
Il y a aussi de fausses évidences pointées par M. Lamiri, comme celle faisant croire que l’Algérie consacre beaucoup d’efforts à l’éducation et à la formation. En fait, l’Algérie fait moins que les pays émergents. L’éducation absorbe 5,5% du PIB en Algérie, contre 8% en Corée du Sud. L’administration algérienne a consacré 0,3% de la valeur ajoutée à recycler son personnel, contre 3,5% en Corée du Sud. « On ne peut pas être compétitifs face à des pays qui fournissent un effort dix fois plus élevé » pour améliorer le niveau du personnel, dit-il.
Timide inclinaison
Y a t-il un espoir que les choses évoluent ? M. Lamiri reste sceptique. Ces questions ont été abordées au cours de la tripartite, mais le gouvernement algérien n’a pas encore pris le virage, selon M. Lamiri, qui relève toutefois une très légère inclinaison : le gouvernement consacrait jusque-là 95% de son effort à l’investissement dans les infrastructures, pensant que « ça allait pousser le pays vers le développement ». Il commence à s’orienter vers l’industrie productive, mais tout ceci reste « trop timide ».
De plus, cela ne s’appuie pas suffisamment sur le « troisième pilier », celui des ressources humaines, « pas assez financé en Algérie », selon M. Lamiri, qui assène cette sentence : « tout ce qui fait fonctionner l’économie de production fait défaut », à cause notamment d’un « management inefficace ». Cela débouche sur des résultats trompeurs. L’Algérie prévoit une croissance de 4% en 2014. Ce serait un bon résultat si on mettait 5% du PIB dans l’investissement, pas lorsqu’on met 22 à 25%.
Investir autrement
Le constat établi par M. Zeine Zidane, chef de la délégation du FMI, va dans le même sens. L’Algérie recourt à l’investissement public à un rythme « pas soutenable » sur le moyen et long termes, a t-il dit. Plus grave encore, elle a un potentiel de croissance beaucoup plus élevé, mais elle n’arrive pas à le mobiliser. Pas assez de crédits à la production, et une mauvaise gestion des investissements. « Il ne s’agit pas de stopper l’investissement, mais de le faire de manière différente », déclaré à Maghreb Emergent un économiste. « De toutes les façons, moins de la moitié des crédits sont consommés », ajoute-t-il. « A quoi ça servirait de continuer à annoncer des chiffres faramineux quand on sait à l’avance que ça restera au niveau des intentions ? », se demande-t-il.
Cet économiste s’inquiète aussi des coûts insoupçonnés de certains investissements. L’autoroute est-ouest n’est pas encore achevée, et des tronçons entiers sont déjà en cours de réfection, dit-il. Ces projets ne risquent-ils pas de devenir des gouffres financiers, avec les frais d’entretien qui s’ajoutent aux surcoûts, aux gaspillages, à la mauvaise gestion et aux commissions éventuelles ?